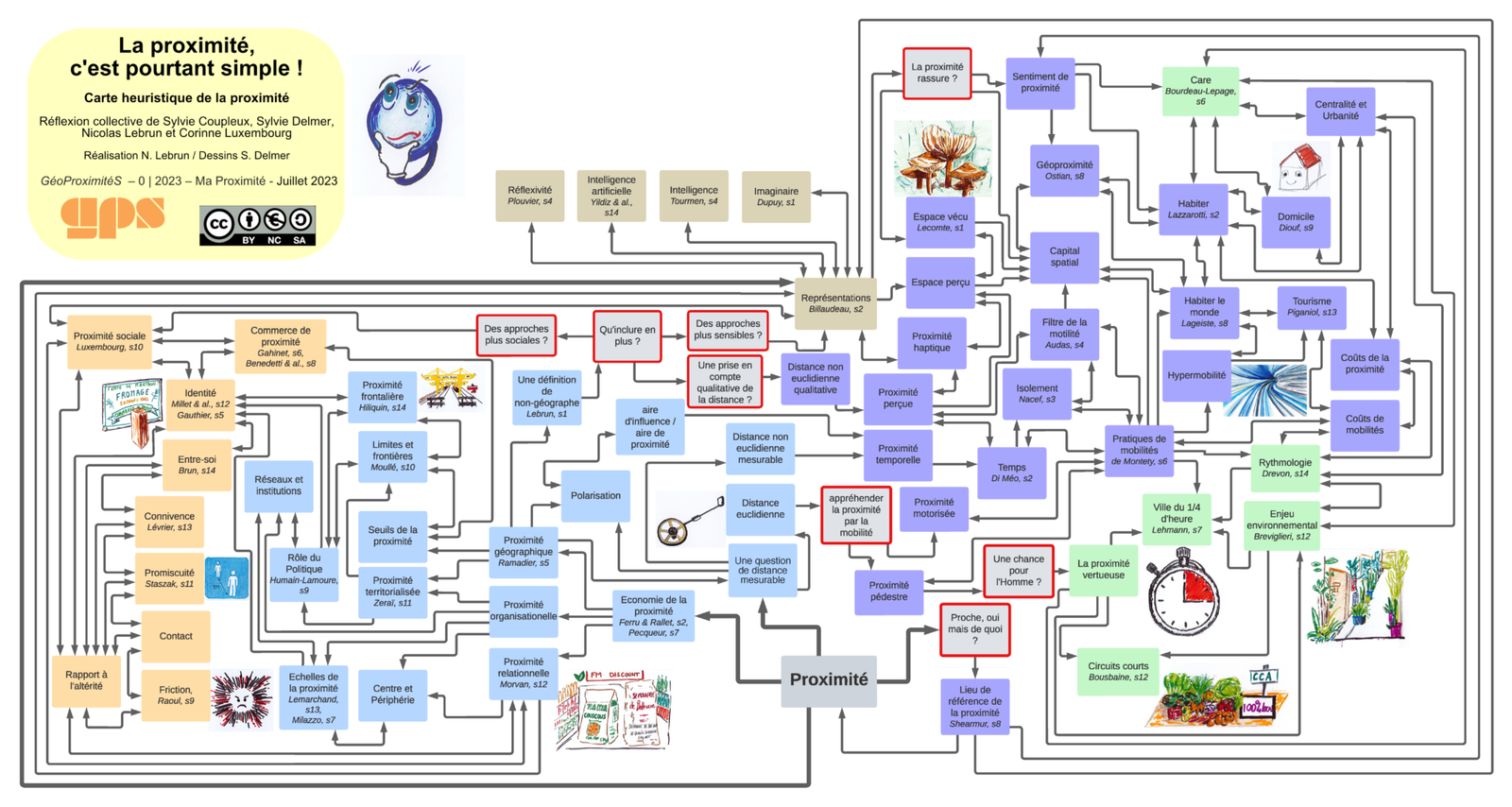Télécharger l'article. 0-2023 Lazzarotti
C’était, je dirai, il y a un petit moment. Dans ces temps où le monde, ouvert, avait fait de la Chine une destination heureuse. J’y étais donc, et j’étais loin. Loin d’ici. Loin, pour moi. Dans cette Chine couverte de bambouseraies. Au moindre frisson de l’air, elles répondent aux vents par une vibration de feuillages bourdonnant dans toutes les dimensions de l’espace. Se mêlant et d’entremêlant, les mouvements de ces vénérables monocotylédones teintent alors d’une multitude de verts les collines bombées de l’intérieur du Fujian. Dans ma tête, je me disais qu’aux anciens temps des Empereurs, quelques faunes tigrés avaient bien dû, rôdant majestueusement, traverser d’un seul de leurs regards toutes les défenses des paysans affairés dans les plats de leurs rizières ou les pentes de leurs plantations de thé.
Vus, les paysages aux allures si typiques de la Chine tropicale et des populations Hakka ne quittent plus la mémoire. Peut-être parce qu’ils sont maquillés de vastes cercles ocres. Prenant de la hauteur, on pourrait les comparer à des ronds de couleurs répartis sur la palette d’un peintre. S’approchant, on découvre une porte. Comme elle est étroite pour de si imposantes constructions. Entrant, se dessine un cercle de deux à trois étages. De fragiles cloisons de bois découpent le bâtiment selon une logique que je ne pouvais que comparer – souvenirs de cartographies – à des tranches de camembert. J’étais dans un Tulou. Je compris qu’ils étaient les résidences que construisaient et occupaient des clans familiaux. Le logement est donc collectif. Mais, à l’intérieur, chaque famille dispose d’une « tranche » selon la logique verticale du fromage normand. Au passage, on comprend que la séparation espace public – espace privé n’est pas aussi claire qu’elle ne l’est ailleurs, en Europe par exemple. L’intérieur du cercle (je dois préciser que les Tulou sont le plus généralement ronds, rarement quoique parfois carrés) est une vaste cour pavée que le toit ne recouvre pas dans sa totalité. Juste en face de l’entrée, la place est réservée au temple des ancêtres. C’est ici que se forge et s’entretient le sentiment collectif. Au centre du cercle, se trouve généralement un puits. Ici, une petite réserve le signale. Dans ses eaux pures et transparentes, un poisson semble dérouler une vie bien paisible. Il ne sait sans doute pas qu’il veille, au gage de sa propre vie, sur celles des habitants.
Traversant ces lieux, les yeux écarquillés, me demandant à tout instant si je suis bien là ou si Freud m’habite, je ne peux m’empêcher de penser à tout le chemin qu’il a fallu faire pour y arriver. Tout l’enchaînement des rencontres qu’il a fallu nouer pour traverser un si vaste pays dont ne je connaissais ni la langue, ni les mœurs. Tout en constatant que les restaurants dits chinois de Paris – et même de France –, et sauf exception, ne le sont que métaphoriquement. Je pensais alors que c’est peut-être cela que veut dire « être loin de chez soi » : savoir que si l’on perd la personne qui vous accompagne – disons son guide – on se perd soi-même… Dans ces conditions, personne ne peut avoir les poches suffisamment amples pour contenir tous les petits cailloux qu’il aurait fallu que je semasse depuis mon départ pour me donner ne serait-ce qu’une chance d’y revenir… seul ! De Roissy à la bruyante Shanghai, arrivé à une heure qui n’est pas la tienne pour prendre un repas qui n’est pas le tien… Ou pas encore. Mais aussi de Shanghai à la portuaire Xiamem. Et puis de Xiamen à Tian Luo Keng, Taxia, Gaobei, Chuxi… Autant de noms qui, à eux seuls, m’évoquent des lieux si improbables, tellement perdus dans les brumes de mes inconnus. Pourtant, et très vite, je m’y étais fait – comme on dit –. Les paysages, les odeurs, les sons, les gens. Peu à peu, j’apprenais à reconnaître leurs visages. À saisir, çà et là, quelques mots, au mieux, de vagues intentions, parfois. Ou rien du tout, le plus souvent. Alors, faire semblant pour donner le change, mais risquer de creuser l’abysse de l’incompréhension ? Ou rester ce que le visage dit que l’on est : un étranger ?
Dans ces moments-là, aucun des moindres détails de l’océan d’altérités qui m’entourait ne me faisait manifestement signe. Sans que je le décide vraiment mes pensées s’égaraient dans un vague refuge. Je voyais ces hommes et ces femmes quittant leur pays pour en habiter un autre et tout ce qu’ils avaient dû y éprouver pour s’y attacher et s’y faire reconnaître. Pour me rassurer, je vérifiais, un peu comme l’assoiffé ne lâche pas sa gourde, que j’avais bien encore sur moi l’ensemble de mes « papiers », comme on dit, ceux qui font la différence entre un voyageur légitime et un autre, certains parlent de clandestins. Comme si l’on n’était pas tous un peu des clandestins…
Légalement, ce n’était pas notre cas. Le retour à Shanghai se fit donc simplement, en TGV, achevant sur rail ce déplacement sur les terres du patrimoine mondial à la chinoise qui avait commencé dans les airs. Bien niché dans mon siège, le corps se relâche. Les images des lieux visités défilent un peu. De lui-même, le cerveau fait son œuvre. Il choisit, retient, revisite, oublie… Il le fait d’autant mieux que l’attention lâche prise, comme on dit maintenant. Le train, c’est du connu. Le lointain s’y rapproche, si l’on peut dire. Le regard perdu dans les paysages qui défilent à plus de 300 km/h, immobile en mouvement, il me revint alors un détail. Je nous revoyais, au début du voyage, à l’arrivée, à Xiamen. Une salle d’aéroport. Un tableau d’affichage : illisible pour moi, à l’exception, d’une ou deux villes dont je connais l’écriture : Shanghai, Beijing, Ningbo. Ça fait peu pour être et moins encore pour aller. Pour autant, et sans qu’il m’en coûte, l’heure approchait. Elle nous suggérait maintenant de quitter notre repère pour une autre salle. Plus un large couloir qu’une salle du reste. Un peu au fond, s’achevait la terminaison descendante d’un escalier mécanique. C’est intéressant à regarder, un escalier mécanique. Le fixe et le mobile s’y combinent étonnamment. Le passage des marches fixe le rythme. Mais leur effacement progressif donne l’impression d’un mouvement continu.
Ce qui me tira brusquement de ma rêverie, ce fut l’appel, presque le cri, de mon collègue au français impeccable : « Marie-Charlotte, Marie-Charlotte… » dégaina-t-il comme le javeloïste libère son trait. Et en effet : prise dans la somnolence mécanique d’un escalier qui ne l’est pas moins, je reconnus en moins de temps qu’il faut pour le dire, le rayonnant visage de ma propre fille débarquant tout juste de Shanghai.
Aujourd’hui, loin de Xiamen, du Fujian et peut-être même de la Chine, parfaitement installé dans les lieux familiers de mon immédiate proximité, pour peu qu’il reste quelque distance entre eux et moi. Donc, dans un monde qu’Henri Dutilleux lui-même n’aurait pas pu mieux qualifier que de lointain, je me dis que, ce jour-là, dans ce lieu-là, avec toute la puissance invisible de ce qui se loge dans les apparences de l’anodin, j’avais fait, alors et peut-être parce que je m’y attendais le moins, l’expérience conjointe de la plus grande proximité et du plus lointain. Plus tard encore, je compris que, comme il n’y a pas de fixe sans mobile, il n’y a pas de proximité sans lointain : habiter.
Pour citer cet article : LAZZAROTTI Olivier, « Proximité… hum… Laisse-moi un peu réfléchir. Ok… », 0 | 2023 – Ma Proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/2023/09/10/proximite-hum-laisse-moi-un-peu-reflechir-ok/