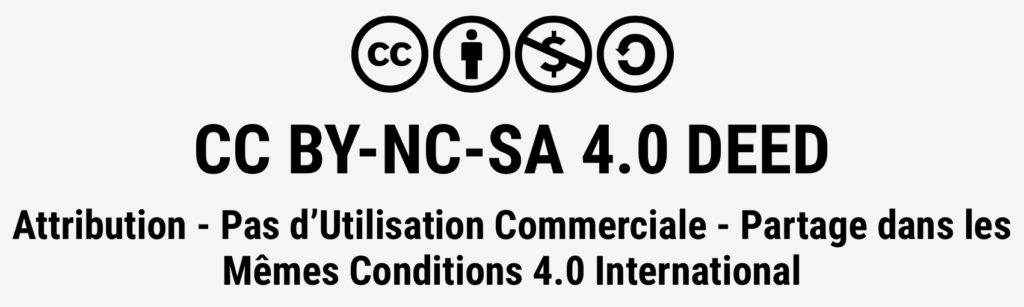Maintaining one’s proximities. Associative sociability and representations of proximities in intermittent forms of inhabiting rural areas.
Sara Escudero Rubio
〉Doctorante en anthropologie
〉Université Paris Nanterre
〉UMR 7218 LAVUE – LAA
〉sara.escuderorubio@gmail.com
〉Article long 〉
Télécharger l'article. 4-2024 Escudero Rubio
Résumé : Cette contribution interroge des pratiques de sociabilités développées en milieu rural pour construire et représenter des proximités aux lieux et aux autres alors que le quotidien n’est pas (ou plus) partagé du fait que la résidence habituelle est ailleurs. Il se focalise sur des manières de maintenir ou d’entretenir une présence dans des réseaux de sociabilité locaux pendant les moments de présence temporaire sur le territoire, mais aussi pendant l’absence. L’article explore particulièrement l’engagement dans le monde associatif (clubs sportifs et comités des fêtes), au quotidien comme sur les temps forts. Les matériaux convoqués sont issus d’un travail ethnographique en immersion dans le cadre d’une recherche doctorale en cours, combinant observations participantes et entretiens approfondis avec des habitants présents selon différentes temporalités, rythmes et formes..
Mots-clés : rural, habiter, sociabilités, pratiques, présence-absence, représentation
Abstract: This paper examines sociability practices developed in rural areas to create and represent proximity to places and to others, when everyday life is not (or no longer) shared because the person’s regular residence is elsewhere. It focuses on ways of keeping or maintaining a presence in local sociability networks during temporary periods spent on the territory but also when away from it. The article explores particularly involvement in local associations (sports team and events committee) both daily and for major social events. Data is drawn from an ethnographic immersion in the framework of an ongoing doctoral research project, which combines participant observation and in-depth interviews with inhabitants who are present at different temporalities, rhythms and forms.
Keywords: rural, inhabiting, sociability, practices, presence-absence, representation
Partant du constat que le village ne représente pas une entité relationnelle isolée, comme le montre par exemple Patrick Champagne déjà dans les années 70 (1975), et d’une dissociation généralisée entre les lieux qui composent les espaces de vie des habitants, il est possible de relever en milieu rural un éventail de formes d’habiter intermittentes, définies par des temporalités et des périmètres spatiaux différents. Contrairement à la pratique d’une multiplicité de déplacements pendulaires à des distances variées et limités dans le temps de la journée (on se déplace pour nos activités, mais on revient chez soi le soir), les intermittences se développent à une échelle non quotidienne. C’est-à-dire, ce sont des déplacements qui impliquent le fait de séjourner de manière réitérée : une discontinuité qui entraîne une « proximité géographique temporaire » (Torre, 2009). Ils ne convoquent pas une seule forme de propriété telle que l’achat d’une maison secondaire, mais concernent une myriade de situations résidentielles : les venues peuvent se faire pareillement à une maison de famille partagée, au foyer familial, chez son copain/conjoint, à une maison louée de manière réitérée au cours des années voire des générations, etc. On parle de situations de « multirésidentialité », dépassant l’approche unique et administrative de la résidence secondaire, et mettant aussi en question le caractère « secondaire » pour ceux qui les habitent (Stock, Rérat & Ruegg, 2018, p. 5).
Ce mode d’intermittence permet de saisir une dimension relationnelle de la proximité qui dépasse la condition kilométrique et qui ne se réduit pas au fait de partager de manière continue un même espace géographique[1]. Sur cette base, on émet l’hypothèse qu’à travers l’habiter intermittent il est possible d’observer des pratiques d’entretien de ladite proximité. Cela pose la question des manières dont se conjuguent les distances géographiques avec les proximités affectives et relationnelles pour alimenter des liens spatialement situés alors qu’un quotidien à proprement parler sur place n’est pas ou n’est plus partagé.
Parmi ces habitants intermittents, on se focalise sur ceux qui sont dans une démarche d’intentionnalité spécifique : ils cherchent à établir ou à conserver des proximités à des espaces de sociabilités locales. Selon les contextes, il peut s’agir d’un cumul de sociabilités entre lieux habités, comme du choix de déployer des sociabilités principalement dans un lieu qu’ils n’habitent pas de manière continue. Dans les deux cas, il y a une volonté de proximité par les sociabilités. Ils se retrouvent à l’opposé du cas aussi courant d’autres intermittents qui, malgré un rapprochement spatial temporaire (par exemple la venue lors de vacances à une maison secondaire), cherchent un certain isolement, ou partagent le lieu plutôt avec des proches de leur « vie d’ailleurs ».
Dans ce cadre, on interroge des manières de représenter ladite proximité. Ces manières sont entendues ici comme des pratiques, des actes ou des gestes, ainsi que des discours, pour affirmer ou démontrer la proximité. Elles permettent de regarder par quels biais ces habitants intermittents symbolisent, ou opèrent une mise en scène des appartenances locales pour combler leur discontinuité sur place[2]. Concrètement, cet article se concentre sur celles qui s’organisent autour de sociabilités liées au monde associatif traditionnellement structurant de l’activité sociale dans le contexte rural étudié[3] : d’une part autour des sociabilités associées à des clubs sportifs qui s’avèrent des instances de socialisation tels que que les clubs de foot, de rugby et de basket ; d’autre part, associées à des comités des fêtes qui permettent « d’accéder rapidement à des positions visibles et reconnues au sein de la commune » (Schnapper, 2022). Ces pratiques supposent des formes différentes de participation et des degrés variables d’investissement, au quotidien comme dans les temps forts. Elles contribuent à entretenir et à légitimer la place de ces habitants intermittents dans les réseaux locaux d’interconnaissances.
S’appuyer sur les différentes formes de participer à ces réseaux de sociabilités pour s’en montrer « proche » entend mettre en avant le caractère évolutif des proximités : on observe en effet comment elles varient selon le moment du parcours de vie, l’âge, la situation socioprofessionnelle, les liens affectifs tissés ailleurs, les liaisons émotionnelles qui subsistent, etc. Cette approche suppose de croiser l’accumulation des appartenances héritées et des appartenances acquises, avec des combinaisons de facteurs temporels et géographiques qui caractérisent les différents degrés d’absence-présence des habitants intermittents. La juxtaposition de tous ces facteurs configure leur « espace vécu » – engendré par les pratiques et par les représentations issues des expériences individuelles (Frémont, 2009 [1974]). Cela permet de nuancer non seulement différents rapports à un espace géographique, mais aussi des variations dans la proximité recherchée : entretenir sa place, garder sa place ou créer une place.
Afin de travailler ces questions, on s’appuie dans cet article sur une immersion ethnographique menée depuis 2021 dans le cadre d’une recherche doctorale.[4] Elle est mise en place sur un territoire rural à l’est du Gers composé d’un maillage de communes de petite échelle et de faible densité[5] qui se situe à environ une heure de voiture de Toulouse. L’observation participante, associée à la réalisation d’entretiens approfondis[6], se déroule à l’échelle d’une constellation de lieux que je fréquente par des sociabilités quotidiennes, mais aussi associatives et festives, et qui ne se limitent pas au contour administratif de l’intercommunalité. Cela répond au fait que sur ce territoire, où la majorité des communes sont dépourvues de cafés et de bars, les sociabilités prennent place essentiellement dans l’espace privé et dans la sphère associative. On observe que les réseaux associatifs, malgré leur vulnérabilité en raison des difficultés croissantes pour recruter des bénévoles, restent très actifs et structurent fortement les sociabilités populaires. S’investir dans les clubs sportifs comme le foot, mais aussi dans les comités des fêtes ou dans la société de chasse, situe les gens dans des espaces de sociabilités quotidiennes, favorisant l’insertion dans des réseaux d’interconnaissances.
Parmi la population enquêtée, on compte une trentaine de ménages d’habitants intermittents présents selon différents rythmes et différentes formes, aux profils très hétérogènes à plusieurs points de vue. Certains sont propriétaires alors que d’autres reviennent dans la famille ou sont locataires. Professionnellement, on rencontre des étudiants (université, BTS…), des retraités, et des actifs (parmi lesquels nous retrouvons des cadres supérieurs, des professions intermédiaires et des employés). Une partie des enquêtés, malgré qu’ils vivent ce lieu de manière intermittente aujourd’hui, l’ont vécu auparavant de manière continue pendant plusieurs (voire nombreuses) années. Il a constitué à un moment de leur vie leur résidence principale, souvent foyer familial et lieu des socialisations primaires. Pour certains, les départs se caractérisent par un « maintien » des pratiques et des liens comme l’évoque Paul-André Rosental (1990). Toutefois, on peut noter que ce maintien est souvent nuancé : il est plus ou moins fort selon les contextes géographiques et sociaux de chacun, et ne s’oppose pas au développement « de bases domestiques doubles » (Alicea dans Becker, 2002, p. 212). De plus, cette quête de proximité est loin d’être exclusive à ceux qui ont vécu le lieu de manière continue ou à ceux « du coin ». Elle se retrouve aussi chez des enquêtés pour qui le lieu a toujours été vécu de manière intermittente, ainsi que chez ceux qui n’y sont pas nés ou qui n’y sont pas implantés depuis des générations. Les liens avec les lieux viennent autant des mémoires héritées, à l’image d’un passé familial, qu’ils peuvent s’acquérir par une pratique nouvelle, comme la venue à une maison de vacances. Ainsi se constituent des repères spatio-temporels qui servent « à la fois de bornage et de tremplin pour l’avenir, y compris comme lieu où revenir au terme d’un voyage. » (Zask, 2023, p. 13).
Par ailleurs, et en lien étroit avec les ressources économiques et les temps dont chacun dispose pour venir à ce lieu selon le moment de leur vie (situation familiale, activité professionnelle…), il faut considérer les dimensions temporelles et spatiales des intermittences. Au-delà des temps longs et cumulatifs liés au vécu, les présences sur place sont définies par l’enchevêtrement des fréquences, des intervalles et des durées des séjours, avec les distances géographiques à parcourir. S’il n’y a pas corrélation entre la proximité relationnelle et la « quantité de temps » passé sur place ou avec la « quantité de kilomètres » à parcourir, celles-ci vont rendre possibles différentes intensités de présence et de participation. Ainsi, l’hétérogénéité des interlocuteurs montre une diversité de rythmes de présence, de l’hebdomadaire au très ponctuel. Elle montre aussi une diversité de distances au lieu de résidence habituelle. Si certains sont à une heure de route (notamment à Toulouse ou dans d’autres villes environnantes), d’autres résident à plus de 100 km (en France, mais aussi en Europe), ou encore à plusieurs heures de vol. Cela reste à combiner avec les envies et volontés individuelles.
Nous analyserons à suivre différentes pratiques de sociabilité dans le cadre associatif (clubs sportifs et comités des fêtes) qui se développent dans le but d’entretenir les proximités des habitants intermittents. L’objectif n’est pas de confirmer ou de dépasser une dichotomie entre les proximités des uns et des autres (ceux qui sont nés « ici » et des « nouveaux » ; ceux qui ont un lien préalable au lieu et ceux qui ne l’ont pas…). Il s’agit plutôt de rendre compte de la pluralité de formes par lesquelles chacun vise à construire et à représenter ses proximités. Différents degrés de présence et d’investissement seront explorés : de l’engagement hebdomadaire, à des formes de présence dans l’absence, en passant par des agencements menés lors d’un éloignement ou d’une nouvelle venue lors des temps forts des associations.
Entretien hebdomadaire d’un « nous » social
Un mode de présence récurrent sur le territoire est celui de ceux qui viennent, ou plutôt reviennent tous les weekends au foyer familial, à celui de leur conjoint ou encore dans une maison qui leur appartient. Il s’agit souvent de gens qui sont partis pour les études[7] ou le travail, résidant en semaine dans des villes à environ une heure de voiture (comme Toulouse ou Auch), et jusqu’à plusieurs heures. Alors que je menais des séries d’entretiens à des personnes parties loin ou en maison secondaire, j’ai suggéré à une de mes interlocutrices privilégiées d’évoquer son expérience de l’intermittence, dans son cas hebdomadaire, lors de ses études universitaires à Toulouse. Surprise par ma proposition, elle prend soin de préciser sa différence par rapport à mes autres interlocuteurs : elle n’était « pas ‘vraiment’ partie ». Cette différenciation a été mise en avant dans des échanges informels avec d’autres personnes en situations similaires, qui expriment à plusieurs reprises la différence entre eux, établis dans la vie locale, et l’imaginaire projeté sur des « résidents secondaires » (Ortar, 1999). S’il y a en effet un départ, et que la résidence principale au sens administratif[8] est ailleurs, « l’espace investi » (Rosental, 1990) de ces étudiants se développe principalement ici pendant les études. Malgré une présence discontinue, le caractère actif et récurrent donne une impression de continuité.
Puisque les associations sportives suivent aussi des rythmes hebdomadaires – les matchs ont lieu le weekend – il est courant, spécialement dans le cas des jeunes, qu’ils maintiennent leur investissement dans les clubs, comme l’évoque un ancien intermittent :
« En plaisantant, à une époque l’équipe réserve – parce qu’en fait, dans le club de rugby, généralement, il y a une équipe première qui est la meilleure équipe, il y a l’équipe deux qui est l’équipe réserve, où il y a ceux qui sont soit moins bons, soit qui peuvent moins s’entraîner. À une époque, on nous surnommait en rigolant ‘le N.UC’, c’était le [Nom de la commune][9]Universitaire Club. Parce qu’en fait, l’équipe réserve était composée à 80% d’étudiants qui rentraient le weekend. »[10]
Certains se déplacent également en semaine pour l’entraînement, et beaucoup de clubs les organisent les vendredis, leur permettant d’y participer plus facilement.
Les moments sportifs s’accompagnent en général de moments de convivialité après les matchs (comme la « troisième mi-temps ») et après les entraînements (comme le partage d’un verre ou d’un repas). Ces moments de convivialité dépassent aussi les espaces-temps de l’événement sportif, comme des soirées ou des sorties avec les familles, des soirées à thème, la diffusion de matchs, l’anniversaire d’un joueur, etc. C’est pourquoi « entretenir sa place » au sein des associations sportives donne l’occasion de rester actif dans un quotidien social[11] (et de montrer que l’on continue de l’être).
Réciproquement, cette présence hebdomadaire devient nécessaire pour la vie des associations. Prolonger son engagement montre alors non seulement le choix de continuer à partager un style de vie, mais aussi la volonté de le rendre possible. C’est-à-dire que participer au nombre requis pour l’existence des clubs affirme de plus le soutien à la continuité de ces sociabilités. C’est souvent le cas des petits clubs de villages, fragiles vis-à-vis du nombre de joueurs et d’encadrants disponibles. Par exemple, un club de basket féminin, qui s’avère être un espace de sociabilités pour plusieurs générations, compte parmi ses effectifs des étudiantes qui rentrent pour jouer tous les weekends, mais aussi pour organiser les activités. Les entraînements des benjamines sont menés en partie par une étudiante universitaire qui, résidant à Toulouse, revient autant les weekends que pour l’entraînement en semaine. Elle consacre, de manière bénévole, une bonne partie de ses weekends à la vie associative tant comme joueuse que pour les entraînements, les matchs et sorties des jeunes, ou encore pour l’arbitrage. Son engagement permet le maintien d’une forme de sociabilité pour elle, mais aussi pour les autres (coéquipières, enfants et jeunes qui devraient aller plus loin en cas de disparition du club), ce qui génère une forte reconnaissance de la part des membres du club comme des parents. D’une certaine manière, elle devient « indispensable », ce qui renforce sa place au sein des réseaux locaux.
Réduire sa présence, mais être là « quand il faut »
Revenir tous les weekends n’est pas une condition incontournable pour rechercher une proximité ancrée dans les réseaux de sociabilités locales. Prenons le cas typique d’une équipe de foot masculin d’un petit village, aussi en situation de fragilité avec des périodes de manque de joueurs. Prendre une licence est pratiqué par des intermittents hebdomadaires, mais aussi par ceux qui sont amenés à réduire encore plus leur présence sociale sur place en raison des distances géographiques à parcourir. Cette possibilité d’investissement discontinu résonne avec la situation du club, qui joue à un niveau peu compétitif et se revendique comme « une équipe de copains », composée d’une majorité de joueurs reliés par des liens d’amitié ou de famille, d’un nombre réduit de résidents de la commune et d’une minorité préalablement extérieurs aux réseaux des autres joueurs. Comme évoqué par Benoît Coquard (2018), les logiques d’appartenance deviennent plus amicales que territoriales (p.50). Maintenir l’investissement relève pour certains de la volonté de garder une attache au lieu, mais surtout aux gens. Faire partie de l’équipe, c’est pour beaucoup partager des pratiques sociales avec des « potes » (Coquard, 2018). « Prendre sa licence » témoigne dans ces cas d’une intention de « garder sa place » dans un espace social qui ne peut plus être fréquenté de manière régulière.
Il s’agit parfois d’une situation temporaire à durée variable (plusieurs années, quelques mois…). Un joueur explique ainsi que pendant une période de deux ans comme ouvrier agricole à environ 3 heures de route, même s’il a dû changer son niveau d’investissement au bout d’un moment, il a continué à rejoindre l’équipe et à jouer au rythme de plusieurs weekends par mois. De la même manière, des joueurs partis pendant plusieurs mois faire des stages ou des études dans des endroits éloignés sont invités à jouer lors de leurs passages sur le territoire. Certains gestes sont encore commentés longtemps après – j’entends par exemple à plusieurs reprises l’histoire de ce joueur qui était à l’époque en stage dans le nord de la France, et dont on a organisé le retour pour un match décisif et symbolique. On remarque que, tant du côté du club que du côté du joueur, il y a une volonté de garder une position de proximité – « on peut encore compter sur ».
J’ai également pu observer, en cours de saison, le cas d’un départ définitif en raison d’un déménagement à plus de six heures de route, qui ne permet donc pas de retours fréquents ou réguliers. Le détachement du club a été pour lui progressif et relatif, il fait toujours partie de la bande de certains joueurs malgré la réduction de sa présence. Au cours de la saison, lorsqu’il est rentré dans sa famille, il a été convoqué pour jouer. Une fois sa licence expirée, il reste dans le groupe Messenger, retourne soutenir l’équipe depuis les tribunes lors d’événements marquants pour le club, et se rend aux matchs et soirées du foot lors de ses passages sur le territoire (pour des célébrations familiales, fêtes locales, anniversaires importants, etc.).
Être là « quand il faut », indépendamment des distances, appelle dans ces multiples cas un « nous » social et un vécu collectif.
Rattachements calendaires à un « avant » partagé
Un mode de présence physique ponctuelle n’empêche pas de rejoindre ou de participer auxdites structures associatives. Certes, l’investissement en tant que joueur ou comme membre du bureau dans les clubs sportifs demande généralement un minimum de constance, mais d’autres rôles sont possibles. Parallèlement, certaines associations non sportives ont un quotidien qui se déroule sur des rythmes plus saccadés. Ce serait l’exemple des comités des fêtes, pour lesquels l’activité est moins régulière et organisée autour d’un calendrier d’événements sur l’année (fête locale, vide grenier, trails…). Cela permet d’accueillir plus facilement des personnes, présentes aussi de manière moins fréquente, et de produire desalignements calendaires[12] entre habitants présents sur différentes temporalités : ceux qui viennent pendant les vacances à une maison secondaire, ceux qui viennent de manière ponctuelle pour rejoindre le foyer familial, des retraités qui passent ici une partie de l’année, etc.
L’investissement dans ces instances de socialisation, bien qu’en pointillé et même réduit à leurs temps forts, mobilise pour certains le partage d’un passé commun et d’une mémoire collective qui participe de la constitution et du maintien d’un attachement (Paugam, 2023). Cela peut être en lien avec la continuité d’une pratique de famille, comme on peut le lire par exemple dans la récurrence des noms de famille ou de surnoms souvent transmis par filiation (Renahy, 2001) des membres des comités des fêtes et des clubs sportifs notamment au foot et au rugby. Ainsi, pour une de mes enquêtées, la participation au comité des fêtes est quelque chose qui se fait le plus souvent « de père en fils », ou que tu fais « à ton tour » comme les générations précédentes l’ont fait pour toi.
Cette représentation d’une continuité, qui s’appuie sur une proximité ancrée dans le temps long et sur un héritage (de pratiques, mais également d’imaginaires qui révèlent souvent l’idéalisation d’un « avant ») ne s’organise pas seulement autour d’un passé familial, mais aussi d’un passé partagé avec des bandes de copains. Ainsi, au sein de ce petit comité des fêtes de village, composé d’une vingtaine de personnes liées surtout par des relations de famille et de longues amitiés, il est possible de témoigner de l’arrivée ponctuelle de « renforts » résidant parfois à de longues distances. Prenons l’exemple d’un jeune originaire de la commune, parti à plus de 500 km pour le travail et ne revenant que quelques fois par an : plusieurs signaux, comme le fait qu’il garde une place dans le groupe Messenger des organisateurs malgré une participation très limitée (d’autres habitants non intermittents ont été radiés pour son manque de participation), laissent transparaître son passé ici et la proximité avec les gens du groupe. De ce fait, s’il ne participe pas de manière automatique en tant que bénévole, je note la familiarité avec laquelle il l’a fait lors des occasions rencontrées. Par exemple, alors que le vide grenier du village coïncidait avec un long séjour dans sa famille, il s’est montré non seulement disponible pour toutes les étapes – de la préparation au rangement, en passant par le partage du repas entre bénévoles – mais il affichait une confiance certaine. La relation étroite avec tous les membres pouvait se ressentir, autant que le fait qu’il possède « les codes » et les repères sur ce type de manifestation. Dans cette lignée, un autre jeune, originaire d’une commune voisine qui entretient des liens étroits d’amitié avec certains membres du comité, bien qu’il ne revienne qu’une ou deux fois par an (il habite à plusieurs heures de vol), effectue un geste spontané, mais significatif vis-à-vis de cette démonstration de proximité. Pendant la fête du village, il n’a pas hésité à « donner un coup de main » improvisé lors d’un moment de précipitation : pendant la distribution des repas, alors qu’il manquait une personne dans la chaîne de préparation des plateaux, en remarquant que l’on prenait du retard dans le service, il est passé sans tergiverser dans la zone des bénévoles pour préparer des plateaux. Le lendemain, il a mangé à « la table du comité » et est resté pour finaliser le rangement et le démontage de la salle.
Ces exemples, qui s’appuient sur une dimension affective née d’un vécu antérieur et du souvenir d’un lieu, représentent le mode le plus courant de participation dans l’organisation de ces temps forts. Mais le fait de montrer ou de démontrer qu’on a « les codes » autour de l’organisation des fêtes de village apparaît aussi dans des cas d’habitants intermittents qui n’ont pas de lien préalable avec le territoire. Un des enquêtés, d’une soixantaine d’années, qui a acheté avec sa famille il y a environ 25 ans une maison dans une petite commune (avec des venues régulières lors des vacances scolaires), explique que sa proximité avec « les gens du village » est passée par leur intégration rapide au comité des fêtes, suivant une logique de « proximité organisée » (Torre et Filippi, 2005) dans laquelle la structure facilite l’interaction des membres (p. 24).
« (…) Quand on était accueillis, très vite on était associés aux fêtes du village et du coup au comité des fêtes, sans être dans le comité directeur des fêtes, ça on s’en fout, c’est leur affaire entre eux. Nous, on est là pour faire la manutention l’été, tenir la pompe à bière et servir à table. Tout ça, on trouve ça très rigolo. Très sympa, très rigolo. Et la fête du village, ce qui est intéressant c’est quand même toute cette période qu’on a vécue jusqu’au confinement. C’était quasiment pour le village une semaine de vie communautaire. De vraie vie communautaire. Le noyau du village, qui doit faire une trentaine de personnes avec tout le noyau, le cœur du noyau, qui ont passé leur adolescence ici… Le comité des fêtes, il y en a qui sont à Toulouse ! Ceux qui ont été en primaire ici reviennent aussi à la fête du village ; ou toute la famille R., même ceux qui n’habitent plus du tout en [nom du hameau] – le lieu de leurs racines[13]-, revenaient ici. (…) Il y avait une espèce de noyau assez volumineux, de gens qui étaient très ancrés sur [nom de la commune] même s’ils ’y vivaient plus ».[14]
Le fait d’inviter cette famille nouvellement arrivée à joindre le comité des fêtes, et le fait d’accepter l’invitation en retour, montrent la recherche mutuelle d’une certaine proximité qui commence par le partage répété d’une date, occasion de se socialiser. Cet enquêté explique que faire partie du comité est pour lui une manière de se rattacher « à la vie communautaire » et de participer à la faire perdurer. S’il révèle dans ses mots une certaine idéalisation pour un avant collectif, « travailler pour la fête » ne signifie pas dans son cas de donner à voir un passé commun, mais plutôt d’une mise en scène, qui marque une ouverture au présent : l’affirmation d’une volonté de se rendre proche malgré la contrainte d’une absence quotidienne.
Cependant, nous pouvons lire dans son discours une différence entre « eux » et « nous » à propos du fait qu’ils ne font pas partie du bureau de l’association comme ceux qui sont ici toute l’année – « ça on s’en fout, c’est leur affaire entre eux ». Si l’on change le point de vue, un autre membre du comité – non intermittent et né sur la commune, mentionnait d’un ton reconnaissant qu’ « ils travaillent pour la fête comme ‘nous’, alors qu’ils ne sont pas d’ici et qu’ils n’habitent pas ici toute l’année ». Il subsiste aussi dans son discours une forme de différence qu’on n’entend pas concernant les cas précédemment cités : pour ces jeunes « du coin » présents sur le territoire de manière beaucoup plus ponctuelle que cette famille, on dirait que leur présence et leur participation va de soi. Cela révèle le rôle central donné à la présence ainsi qu’au caractère natif de l’habitant. Mais encore, ces facteurs ne peuvent pas se lire de manière isolée, d’autres sont nécessaires pour saisir la complexité des proximités, comme l’investissement, l’intensité de la présence, les affinités, le tissage de liens d’amitié, etc.
Si l’on revient aux pratiques, le fait de ne pas être parmi ceux qui prennent les décisions (trésorerie, configuration des menus, etc.) est dans son cas un choix et non une imposition. Cet interlocuteur explique néanmoins que les tâches qu’on leur a confiées ont évolué au fur et à mesure que leur proximité se construisait : pour eux, « se créer une place » passe par assurer une disponibilité réitérée dans le temps tel que le font, selon lui, d’autres « gens du coin » partis de la commune. Ainsi, cela demande l’apprentissage des « codes » qui entourent ces manifestations, comme la bonne manière de couper le melon, ou savoir où placer untel à son lieu privilégié lors du vide grenier.
Il ne faut pourtant pas supposer la fête du village comme un jalon généralisé de la vie sociale, ou que le fait d’être « du village » ou d’y résider toute l’année signifie qu’il y a une pratique de bénévolat ou d’assistance systématique aux festivités, ce qui pourrait tomber dans des représentations folkloriques ou traditionalistes de la ruralité. Bien qu’elles soient assez présentes dans le sud-ouest, bon nombre de résidents secondaires, mais aussi de gens « du coin » n’y participent pas, d’aucune manière. Le refus de ces formes de sociabilités incarne pour certains la recherche d’une « distance » qui peut vouloir marquer des appartenances sociales différentes (Bourdieu, 2007 [1979]), des centres d’intérêt différents, ou encore des conflits de diverses natures (politiques, personnels…) entre familles, groupes d’amis, voisins, etc.
Proches malgré la distance
Comme on peut voir dans les situations précédentes, la pratique des sociabilités dans le cadre associatif n’engage pas forcément un rôle « principal » ou à responsabilité, tel qu’être joueur ou être au bureau de l’association. De la même manière, « être là » ne veut pas seulement dire aider ou être bénévole : soutenir ces réseaux associatifs peut se faire aussi comme spectateur. Parallèlement, ces pratiques mises en place lors de moments temporaires de présence physique sur le territoire coexistent avec d’autres manières de se montrer « proche » pendant les moments d’absence. Des formes de présence à distance participent aussi de la construction ou de l’entretien d’une proximité.
Nous pouvons parler, d’une part, des représentations que ceux qui sont restés font de celui qui est parti. Toujours dans le cas de cette équipe de football, j’entends à plusieurs occasions parler d’un joueur « mythique » parti à l’étranger. On me dit que quand il rentre il vient « toujours » aux matchs et « même aux entraînements », mais en deux ans d’observations je ne l’ai jamais vu sur la pelouse, et rarement en tribune. On constate néanmoins qu’il est présent par les discours et par les récits des joueurs. Ils mobilisent un passé collectif qui entretient la proximité dudit « joueur » au présent. Malgré une absence physique, sa présence est réitérée dans les conversations quotidiennes sur des moments sportifs, mais aussi sur des anecdotes de soirées ou d’autres moments partagés « avant ».
D’autre part, des représentations des proximités sont mises en place par celui qui est absent. C’est par exemple le fait de rester sur les canaux de communication virtuels (Volpe, 2023), comme les groupes WhatsApp, Messenger ou Snapchat, où se déroule en outre le quotidien des associations : le partage des informations utiles, mais également des blagues, des souhaits d’anniversaire, etc. C’est aussi le cas d’autres pratiques qui n’impliquent pas d’interaction à distance. Prenons l’exemple d’un intermittent dans la cinquantaine qui, sans avoir d’attaches préalables au territoire, arrive en 2017 avec sa famille lors de l’achat d’une maison secondaire à la campagne qu’ils fréquentent de manière régulière (vacances scolaires, et en règle générale un ou deux weekends par mois). Les amitiés forgées au bar de la petite ville adjacente l’ont amené à côtoyer des personnes investies dans le club de rugby local, et de manière ponctuelle à assister à des matchs et d’autres événements. S’il dit regretter de ne pas s’investir plus du fait de son manque d’assiduité, il raconte avec fierté que dans le but d’apporter son soutien, il a été sponsor de l’équipe à travers l’entreprise pour laquelle il travaille à Bordeaux. En contrepoint aux exemples qui illustrent l’intentionnalité de « garder sa place » alors que la présence sur le territoire est réduite, ce cas révèle une autre intentionnalité : celle de se « créer une place » dans des réseaux d’interconnaissances nouvellement fréquentés. Si l’on regarde la situation avec la focale des autres habitants, on constate que son geste ne le place pas dans les histoires ni dans les anecdotes de soirée. À la différence du joueur de foot qui est plus présent dans les imaginaires que sur le terrain, celui-ci ne peut pas s’appuyer sur un passé commun, ou sur un engagement de longue date. Cela ne signifie pas pour autant que sa présence ne se fait pas ressentir au quotidien : son nom sur les maillots, les affiches, etc., laissent une empreinte qui le rend d’une certaine manière présent et participe à lui créer une place au sein des sociabilités locales, malgré la discontinuité physique. Il n’est pas possible de dire qu’il devient « indispensable » (comme l’entraîneuse de basket), mais son soutien participe de la vie et du maintien du club qui a toujours besoin de ressources pour s’équiper. Son don déclenche de ce fait de nouveaux rapports sociaux (Godbout et Caillé, 2010 [1992]) : il gagne accès à de nouvelles occasions pour tisser des liens dans ce réseau, par exemple l’invitation au repas annuel des sponsors organisé par l’association.
Conclusion. Habiter à géométries spatio-temporelles variables
L’habiter intermittent révèle la multiplicité de temporalités et de périmètres qui composent l’habiter comme notion qui dépasse la simple résidence : malgré la distance spatiale, ces intermittents habitent le lieu par le biais d’une proximité relationnelle et affective qui dessine des périmètres nouveaux et multiples. Ainsi, les proximités qui se déploient interrogent les périmètres des appartenances dites locales.
Au-delà de considérer les proximités des uns et des autres selon les seuls critères de l’origine ou de l’éloignement spatial, on rend compte des multiples nuances qui se déclinent selon un ensemble de facteurs qui articulent l’usage, l’investissement et les significations accordées aux lieux. Mettre en avant le « point de vue de la mobilité » (Stock, 2006), sous-jacent aux paramètres spatio-temporels qui caractérisent ces intermittences permet, comme le souligne Mathis Stock (2006) à propos de « l’habiter poly-topique », de bouleverser une « vision sédentariste » qui miserait sur le lieu de naissance ou sur le lieu de résidence comme les lieux principaux où se tissent des relations (p. 6). La variété des situations invite à explorer l’idée d’une relation avec le lieu « quel que soit le rapport matériel qu’il entretient avec lui (i.e. qu’il y ait, ou non, possession juridique, pratique concrète ou seulement représentation mentale) » que Martin de la Soudière (2001, p. 9) nomme « appropriation symbolique de l’espace ». Dans la lignée de cette dimension affective, Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre (2006) parlent plutôt de « l’appropriation ‘existentielle’ » qu’ils décrivent comme le « sentiment de se sentir à sa place voire chez soi quelque part. Ce sentiment d’appropriation se transforme alors en sentiment d’appartenance. » (para.19).
Les différents modes de participation dans les situations analysées permettent d’appréhender le « quotidien » sur place des habitants intermittents, et d’interroger la manière dont il résonne avec le quotidien des habitants à présence continue. Par ces sociabilités se créent des opportunités de fréquenter les mêmes espaces-temps. Mais être dans le même espace géographique n’est pas synonyme ou condition de proximité relationnelle. Les pratiques identifiées visent à la fois à représenter et à nourrir un attachement par l’entretien des proximités. Elles impliquent de voir les autres autant que de se faire voir. Ce sont des actes de démonstration autant que des actes de « maintenance » qui se nuancent selon le vécu, les distances et les intervalles de l’expérience sur place. Les situations explorées montrent ainsi que la proximité peut se créer et s’entretenir en dépassant le couple soi-disant antagonique absence/présence : les pratiques et les engagements développés pendant les moments de présence physique se conjuguent avec des formes de présence à distance (virtuelles, dans les histoires, par des objets…) qui interagissent avec le quotidien sur place. D’une certaine manière, ces formes témoignent du partage de représentations communes.
Références bibliographiques :
Alicea M., 1989, The dual home base phenomenon: A reconceptualization of Puerto Rican migration, Thèse de doctorat, Northwestern University, 190 p.
Bargel L., 2016, « Les « originaires » en politique : Migration, attachement local et mobilisation électorale de montagnards », Politix, n° 113, p. 171‑199.
Becker H.S., 2002, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte (Repères), 360 p.
Biase A. de, Rossi C., Sotgia A., Zanini P., 2016, Paysages en récit : pour une approche anthropologique des l’atlas des paysages de la Seine St Denis, Paris, La Recherche, 315 p.
Bourdieu P., 2007, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éd. de Minuit (Collection « Le sens commun »), 670 p.
Bozon M., Chamboredon J.-C., 1980, « L’organisation sociale de la chasse en France et la signification de la pratique », Ethnologie française, X, 1, p. 65‑88.
Chamboredon J.-C., 1980, « Les usages urbains de l’espace rural : du moyen de production au lieu de récréation », Revue française de sociologie, 21, 1, p. 97‑119.
Chamboredon J.-C., Lemaire M., 1970, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue française de sociologie, 1, 11, p. 3‑33.
Champagne P., 1975, « La restructuration de l’espace villageois », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1, 3, p. 43‑67.
Coquard B., 2018, « Faire partie de la bande. Le groupe d’amis comme instance de légitimation d’une masculinité populaire et rurale », Genèses, 111, 2, p. 50‑69.
Frémont A., 2009, La région : espace vécu, Paris, Flammarion (Champs), 290 p.
Godbout J. & Caillé A., 2010, L’esprit du don, La Découverte, Paris (Sciences humaines et sociales), 356 p.
La Soudière (de) M., 2001, « De l’esprit de clocher à l’esprit de terroir », Ruralia. Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, 08.
Ortar N., 1999, « Les multiples réalités de la résidence secondaire », dans Bonnin P., Villanova R. de (dirs.), D’une maison l’autre, Creaphis, Grêne, p. 139‑154.
Paugam S., 2023, L’attachement social : formes et fondements de la solidarité humaine, Paris XIXe, Éditions du Seuil (La couleur des idées), 630 p.
Renahy N., 2001, « Football et représentation territoriale : un club amateur dans un village ouvrier », Ethnologie française, Vol. 31, 4, p. 707‑715.
Ripoll F. & Veschambre V., 2006, « L’appropriation de l’espace : une problématique centrale pour la géographie sociale », dans Séchet R., Veschambre V. (dirs.), Penser et faire la géographie sociale : Contribution à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Géographie sociale), p. 295‑304.
Rosental P.-A., 1990, « Maintien/rupture : un nouveau couple pour l’analyse des migrations », Annales, 45, 6, p. 1403‑1431.
Schnapper Q., 2022, « Une fête à soi. Migrations résidentielles, luttes de pouvoir et recomposition des sociabilités politiques dans un bourg périurbain », Politix, 137, 1, p. 55‑78.
Stock M., 2006, « L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles. », EspacesTemps.net Revue électronique des sciences humaines et sociales.
Stock M., Rérat P., Ruegg J., 2018, « Editorial : La multirésidentialité en questions », Géo-Regards, n° 11-12, p. 5‑16.
Torre A., 2009, « Retour sur la notion de Proximité Géographique », Géographie, économie, société, 11, 1, p. 63‑75.
Torre A., Filippi M., 2005, « Les mutations à l’œuvre dans les mondes ruraux et leurs impacts sur l’organisation de l’espace », dans Torre A., Filippi M. (dirs.), Proximités et changements socio-économiques dans les mondes ruraux, Éditions Quæ, p. 1‑36.
Volpe V., 2023, Abitare lo spopolamento: leggere e interrogare una dinamica attraverso un’etnografia di Biccari (Fg) comune « intermedio » dell’Italia Meridionale, Thèse de doctorat, Venezia Université IUAV di Venezia, Paris,Université Paris Nanterre, 531 p.
Weber F., 1982, « Gens du pays, émigrés, étrangers : conflits autour d’une chasse en montagne », Études rurales, 87, 1, p. 287‑294.
Zask J., 2023, Se tenir quelque part sur la Terre : comment parler des lieux qu’on aime, Paris, Premier parallèle, 160 p.
[1] Comme le montrent par exemple Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire (1970) à propos de la mixité dans les grands ensembles, pour entretenir une proximité relationnelle il ne suffit pas d’être spatialement proche.
[2] Dans cette lignée, de multiples auteurs décrivent des pratiques par lesquelles ceux qui ne résident plus affirment des proximités liées à des appartenances locales, telles que la participation à la chasse (Bozon et Chamboredon, 1980 ; Chamboredon, 1980 ; Weber, 1982 ; …), le maintien du vote au village (Bargel, 2016), etc.
[3] Cela n’a pas pour but d’affirmer que les associations observées soient les seules qui structurent la scène sociale, non plus qu’elles couvrent la totalité de celles dans lesquelles se mettent en place des pratiques de représentation des proximités.
[4] Doctorat en cours à l’Université Paris Nanterre au sein de l’UMR LAVUE, équipe LAA, sous la direction de Alessia de Biase. Il s’agit d’un partenariat CIFRE avec la communauté de communes Bastides de Lomagne, une intercommunalité rurale d’environ 11 000 habitants.
[5] L’intercommunalité, composée de 38 communes d’entre 50 et 600 habitants et 3 petites villes d’entre 900 et 2300 habitants, est classifiée comme peu dense avec 26,6 hab./km² (INSEE, 2020). Elle présente une très légère augmentation de la population, sans pour autant se caractériser par une présence majoritaire de néoruraux, de touristes ou de résidents secondaires.
[6] Une vingtaine d’entretiens sont réalisés en complément des observations réalisées au sein de différents réseaux de sociabilités. L’objectif n’est pas la représentativité statistique mais la « signifiance » des interlocuteurs, « intimement qualitative et [qui] vise à construire une diversité des récits des interlocuteurs à partir du type d’expérience qu’ils pourraient mettre à l’œuvre en tant qu’habitants de ce territoire spécifique » (Biase et al., 2016, p. 17). Les entretiens ont aussi pour but de me donner accès à des interlocuteurs extérieurs aux cercles d’interconnaissances suivis de plus près.
[7] Il faut noter que cette dynamique se met en place dès l’entrée au Lycée (beaucoup des jeunes sont internes dans des villes environnantes) et se prolonge lors des études supérieures.
[8] « La résidence principale de l’étudiant est celle dans laquelle il doit séjourner pour effectuer ses études ou son apprentissage, même si son domicile légal est encore chez ses parents. » https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/depliant_logement_etudiant.pdf (p.2)
[9] Les noms des communes et des personnes ont été anonymisés. Certains noms de villes n’ont pas été anonymisées dans le but de donner des repères géographiques sur le terrain.
[10] M. A., 54 ans, ancien habitant intermittent : parti à 15 ans en internat au Lycée, il a fait ses études universitaires à Toulouse, suivies d’un parcours professionnel dans plusieurs endroits de la France (à plus de 100 km), dont une bonne partie en région Parisienne (700 km). Il est revenu s’installer en 2020. Extrait d’entretien octobre 2023.
[11] On constate une prédominance masculine dans les sociabilités associatives sportives locales, mais la dimension sociale qui englobe plus que le sport et plus que les joueurs donne aussi une place aux conjointes et amies. Il y a néanmoins des exceptions comme les clubs féminins de rugby et de basket qui sont très actifs et centraux dans la socialisation des jeunes intermittentes comme de celles qui restent.
[12] S’ils ne sont pas directement abordés dans cet article, d’autres « alignements calendaires » liés à des sociabilités sont observés par la participation dans des temps forts sans être parmi les organisateurs. Que ce soit dans la sphère publique (fêtes de village, férias, etc.) comme dans la sphère privée (baptêmes, mariages, grands anniversaires, etc.). Ils prennent place aussi dans d’autres contextes que les sociabilités, par exemple autour de temps de travail ou d’entraide liés à l’agriculture.
[13] Il fait référence à un hameau de la commune où s’installent dans les années 30 une famille très nombreuse d’italiens, qui sont pour la plupart restés sur le territoire.
[14] M. B., 63 ans, en maison secondaire depuis 1998, sans lien préalable avec la commune. Sa résidence habituelle à été très variable dû à son métier, mais ils ont surtout résidé dans une ville à 600 km et à Paris (700 km). Extrait d’entretien juillet 2022.
Pour citer cet article :
ESCUDERO RUBIO Sara , « Entretenir ses proximités. Sociabilités associatives et représentations des proximités dans des formes d’habiter intermittentes en milieu rural. », 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-al16/