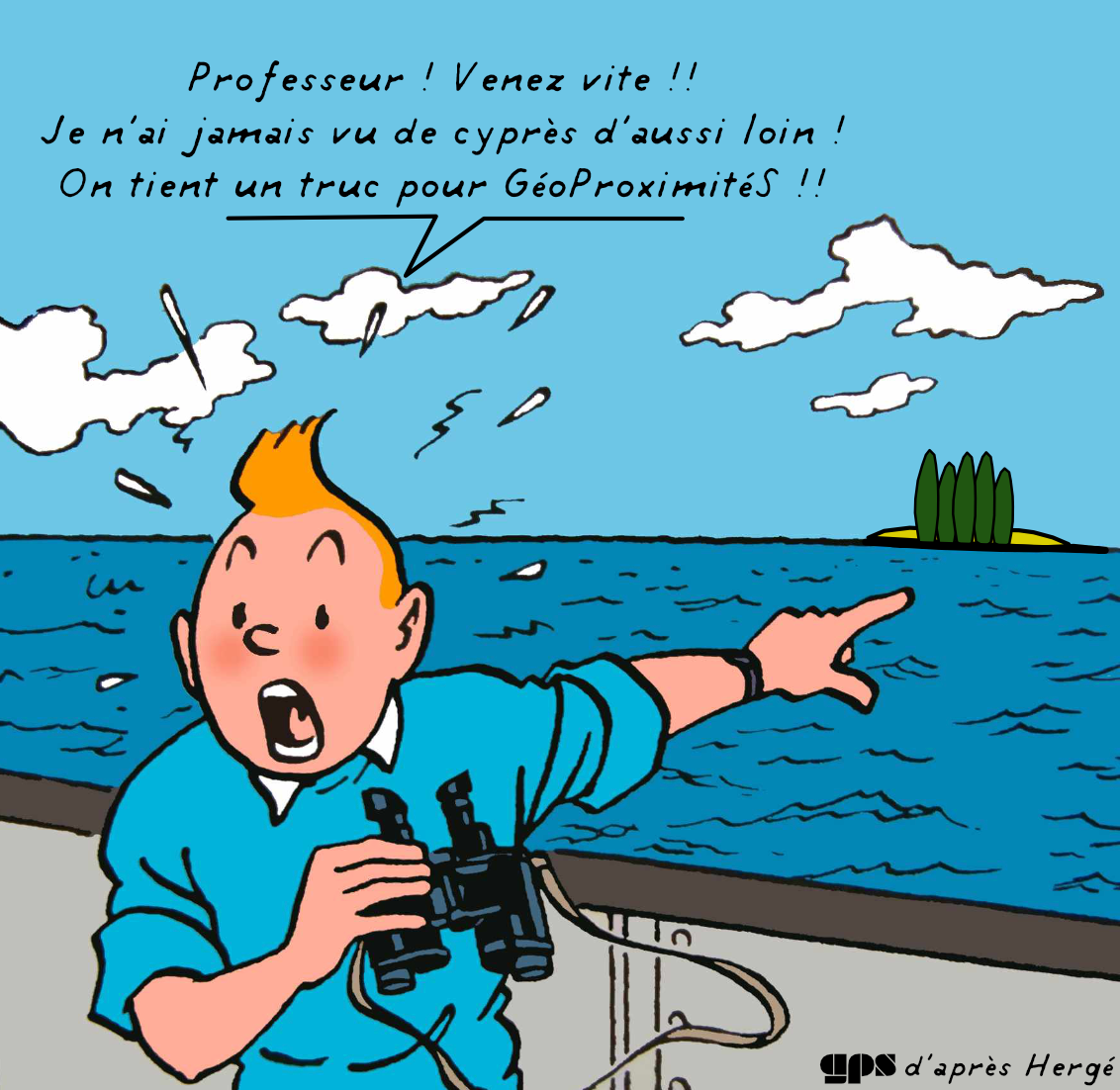Numéro 7-2025 « La frontière : quelles proximités ? »
Coordonné par François Moullé et Fabienne Leloup
Télécharger l'appel à articles
La revue GéoProximitéS (GPS)
La revue GéoProximitéS (GPS) est une revue scientifique à comité de lecture de géographie et de sciences sociales. Son champ thématique est celui des proximités entendues dans toute leur diversité. C’est une revue ouverte à toute discipline de sciences humaines et sociales incluant une dimension spatiale à ses approches. Les numéros de la revue GPS rassemblent donc des articles issus de différents champs disciplinaires autour d’un même thème.
Argumentaire du numéro
La frontière des États-nations constitue une question d’affirmation du pouvoir sur un territoire, la frontière étant la limite où s’exerce la souveraineté du pouvoir politique central ou fédéral. Dans cette approche, la frontière est à la périphérie et le pouvoir au centre. Pourtant, même si les territoires frontaliers peuvent être des marges, ils sont aussi des espaces de vie tels que des espaces urbains extrêmement dynamiques (on parlera alors de transfrontaliers), la frontière pouvant alors être une ressource (Sohn, 2014). La proximité est une configuration spatiale dans laquelle la distance est suffisamment réduite pour que des effets, des usages et des pratiques spécifiques se développent (Lebrun, 2022).
L’idée de proximité vis-à-vis de la frontière peut être vue comme une proximité avec la ligne frontière ou/et avec l’espace frontalier au-delà de la ligne. Christiane Arbaret-Schulz (2002) a ainsi établi que la frontière mettait de la distance dans la proximité. Cela voudrait dire que la nature de la proximité en contexte (trans)frontalier pourrait être perturbée puisque les relations de proximités resteraient marquées par la présence de la ligne frontière séparant les deux souverainetés distinctes. La proximité (trans)frontalière sous-entend que la ligne n’est pas une fin (confins), mais la présence proche d’une ressource territoriale possible. Comme le précise Nicolas Lebrun, la proximité reste une possibilité d’utiliser la ressource territoriale présente au-delà de la frontière, elle devient réalité lorsque les flux transfrontaliers la concrétisent en proxibilité (Lebrun, 2024), ce qui permet d’envisager la frontière au cœur d’une approche relationnelle de l’espace (Pumain, 2009). Cela vient enrichir la people’s approach (Van Houtum, 2000) de la frontière des auteurs anglophones et permet de mieux comprendre la complexité de l’homotone (Moullé, 2003) où un bassin de vie transfrontalier existe sans éliminer l’existence de la frontière en tant que ligne, ni sa dimension symbolique. Nous parlons ici par exemple de travailleurs frontaliers, de couples binationaux, d’opportunités marchandes liées aux différences réglementaires, fiscales et sociales, etc. La distance symbolique de la frontière est ici perturbée par la proximité métrique. Or, à la frontière, la proximité, comme la distance, relève de la métrique, du temps, de la représentation individuelle et collective et d’une dimension symbolique. Il y a bien des individus qui se tournent vers la frontière dans une logique de proxibilité, tandis que d’autres tournent le dos à la frontière (Hamez, 2015). Un dialogue transfrontalier peut même apparaître, qui se caractérise par le rôle de diplomates (Moullé, 2024) des acteurs des territoires locaux et régionaux favorisant des liens de proximité.
Le lien entre proximité et frontière se situe entre les forces centripètes de la frontière offrant des opportunités et les forces centrifuges où les dimensions symboliques et fonctionnelles de la frontière sont des freins aux relations. Les effets de la frontière sur les territoires restent complexes et soulignent l’intérêt de les croiser avec la notion de proximité. Cela est encore plus pertinent dans les contextes nouveaux d’informatisation où de fortes relations de proximité peuvent se réaliser avec une frontière de plus en plus appareillée électroniquement pour surveiller, contrôler et filtrer les flux. La proximité en contexte transfrontalier révèle la complexité de l’idée de dévaluation de la frontière, les opportunités de traversée de la frontière peuvent se multiplier tout en utilisant un appareillage techno-politique sophistiqué permis par les hautes technologies contemporaines.
Cet appel propose quatre axes de réflexions :
- Proximité(s) et symbolique(s) de la frontière
- Pratiques et usages de la frontière dans la proximité
- Mise en scène de la proximité en contexte (trans)frontalier (acteurs et enjeux)
- Politiques publiques et proximité(s) (trans)frontalière(s)
Références
Arbaret-Schulz Christiane, 2002, Les villes européennes, attracteurs étranges de formes frontalières nouvelles, in ReitelB. et alii (éds.), Villes et frontières, Anthropos-Economica, Collection Villes, 213-230.
Hamez Grégory, 2015, Pour une analyse géographique des espaces transfrontaliers, HDR, Université de Rouen, 276 p.
Van Houtum Henk, 2000, An overview of european geographical research on borders and border regions. Journal of Borderlands studies, 15(1), p. 57-83.
Lebrun Nicolas, 2024, De la proximité en tant que ressource territoriale à la proxibilité en tant qu’actif territorial. Pour une société hyperproxible dans un monde en transitions, GéoProximitéS, 4
Lebrun Nicolas, 2022, Proximité, Géoconfluences, Glossaire, octobre
Moullé François, 2024, Une diplomatie territoriale complexe pour connecter les territoires de l’Union européenne, L’Information géographique, A. Colin, n° 1/2024, pp. 37-53
Moullé François, 2003, Dynamiques transfrontalières et identités territoriales. L’exemple des Alpes de Savoie, de la Suisse Romande et du Val d’Aoste, Presses Universitaires du Septentrion, 473 p.
Pumain Denise, 2009, « Essai sur la distance et l’espace géographique », Atala, n° 12, pp. 33-49.
Sohn Christophe, 2014, Modelling cross-border integration: The role of borders as a resource, Geopolitics, vol. 19-3, p. 587-608
Responsables du numéro :
François Moullé, Maître de conférences HDR, Université d’Artois
Fabienne Leloup, politiste, professeure ordinaire, UCLouvain
Modalités de contribution
Consignes aux auteur.es :
Les auteur·rices doivent envoyer leurs articles à la revue et aux rédacteur·rices du dossier thématique. Ces articles peuvent être basés sur une étude de cas ou offrir une perspective plus théorique, épistémologique.
La revue utilise une évaluation systématique en double aveugle et toutes les propositions d’articles sont évaluées par deux évaluateur·rices.
Deux formats de propositions d’articles sont possibles :
- Les articles longs. Les articles font 25000 à 50000 signes espaces comprises, hors bibliographie. C’est le format « classique ».
- Les articles courts. Les articles font 6000 à 11000 signes espaces comprises, hors bibliographie. Ce format, plus incisif, permet d’avancer des éléments plus réflexifs et conceptuels. Il ne s’agit en rien de brèves ou de notes, mais d’articles scientifiques sur un format plus court.
La date limite de réception des propositions est fixée au 03 juin 2025, pour publication à l’automne 2025.
Les normes de publication sont détaillées dans la rubrique du site dédiée.
Les contributions sont à adresser :
- à la revue ( revue.gps(at)gmail.com ), qui accusera réception