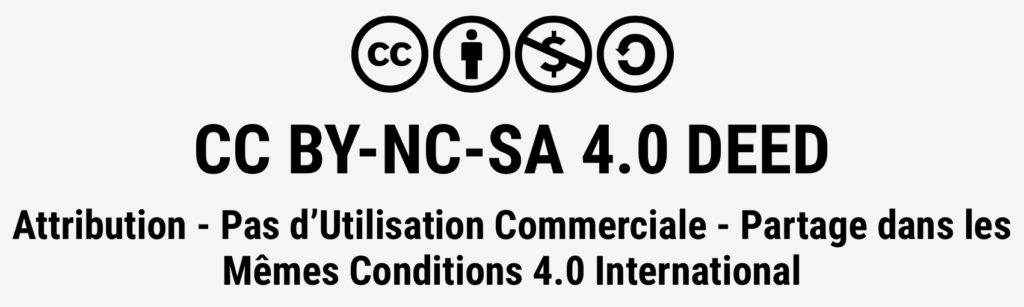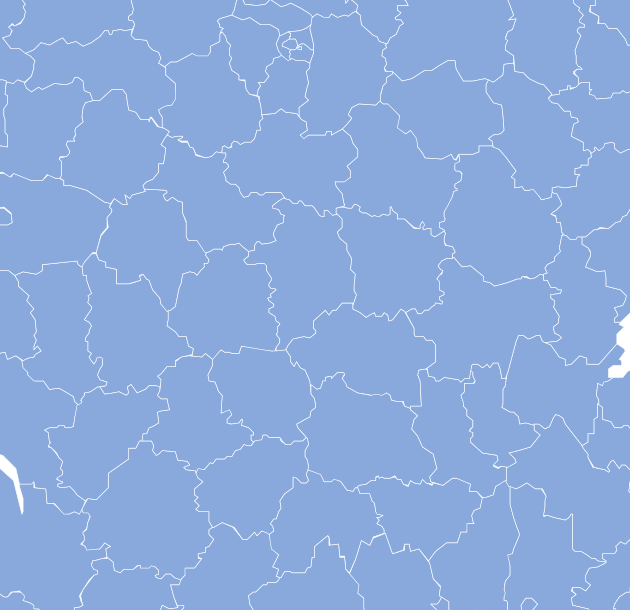Proximity as a departmental project: a permanent selective adjustment
Patrice Diatta
〉Politiste, Docteur-chercheur
〉Cabinet d’études Ixsane SAS
〉Chercheur associé à l’ULR 4477 TVES
〉patrice.diatta@gmail.com
〉Article court 〉
Télécharger l'article. 4-2024 Diatta
Mots-clés : Proximité, égalité, Département, territorialisation, services publics locaux
Abstract: Created as the main level of territorial, social and political proximity and equality during the French Revolution, the Département is increasingly seeing these historic attributes challenged by the Communes and the Régions. In this context of coexistence of different levels of proximity, what about the Département ? Specifically, what does it mean for a Département to embody and/or provide the proximity today, in terms of both territorial location and service organization ? Based on a survey of the dynamics of the territorialization of departmental services in Isère and Meurthe-et-Moselle, this article analyze the Department’s project and actions in terms of proximity. The first part highlights the work involved in redefining the territories that support the department’s local presence. The second part shows the role played certain managers and elected representatives in redefining the content of proximity. The results of the study reveal that the respective processes followed by each of the two Departments are not linear. They show the evolving nature of representations of proximity, according to successive presidencies or political alternations at departmental executive level, or according to territorial reforms.
Keywords: Proximity, equality, Department, territorialisation process, local public services
Introduction
L’histoire de l’administration territoriale en France depuis la Révolution française rappelle que l’idée de « proximité » a été souvent mobilisée comme un des corollaires du principe d’égalité matérialisé en 1790 à travers la création des Départements comme circonscription administrative. Dans un article paru en 1990, Marie Vic Ozouf-Marignier souligne que « en voulant remodeler le découpage territorial de la France, les révolutionnaires sont convaincus de l’idée qu’un partage adéquat du territoire permettra l’avènement de la société idéale […] L’égalité politique va être produite par l’égalité territoriale, d’où l’idée de ce quadrillage géométrique de la France, ces quatre-vingts départements subdivisés chacun en neuf districts égaux, subdivisés chacun en neuf cantons égaux » (1990, p.11). Abondant dans le même sens, Philippe Estèbe rappelle que « l’égalité des territoires est, dans l’imaginaire « républicain », la version géographique de l’égalité politique et sociale » (2015, p.2).
Mirabeau, qui fut un des éminents membres de l’Assemblée constituante ayant instauré la nouvelle organisation territoriale de la République, prononça en 1789 un discours dans lequel il exprima son souhait que ce qui allait devenir les Départements soit « une division matérielle dont l’objet ne fût pas seulement d’établir une représentation proportionnelle, mais de rapprocher l’administration des hommes et d’y admettre un plus grand concours de citoyens » (FranceArchives, 2023). Cette volonté de rapprocher, à partir de l’échelon départemental, l’administration centrale incarnée par l’État des citoyens répartis par Départements fut même traduite dans la fameuse règle qui voulut que chaque habitant, quel que soit sa localisation, devait pouvoir se rendre à cheval en moins d’une journée au chef-lieu de son Département.
Néanmoins, si aujourd’hui, le Département peut être encore considéré comme cet échelon de proximité héritier de la Révolution française, il reste que depuis notamment la loi de décentralisation de 1982, cette prérogative lui semble de plus en plus disputée voire contestée. Les Communes et les Régions, érigées en collectivités territoriales de plein exercice – en même temps et au même titre que les Départements – grâce à la loi de décentralisation du 2 mars 1982 sont désormais reconnues, à leur tour, comme aussi des échelles de proximité. Ce qui engendre parfois un débat quant à laquelle des trois échelles institutionnalisées (région, département ou commune) s’avère la plus pertinente pour conduire une action publique de développement territorial de proximité (Thomas, 2015 ; Sénat, 2020, Guerrin, 2021). Et la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ne clôt pas le débat et les controverses. Car elle n’attribue à aucun de ces trois types de collectivités territoriales le monopole d’espace de proximité. Au contraire, au nom de la démocratie de proximité, et donc la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics, la loi oblige Régions, Départements ou Communes de plus de 10.000 habitants à créer une commission consultative des services publics locaux présidée par le maire, le président du conseil général ou régional (article 5). Ce qui signifie qu’indépendamment du périmètre d’action, la loi associe ici la proximité à la taille de la population. La proximité n’est donc pas que territoriale. Les grandes collectivités de plus de 10.000 habitants sont ainsi appelées à construire des espaces de proximité de leurs services publics avec leurs habitants, à travers la mise en place d’instances consultatives permettant l’information et l’association des citoyens à la gestion de tels services.
En rappelant rapidement ces constats relatifs à l’évolution des représentations de la proximité dans le sillage de l’histoire de l’administration et des réformes territoriales en France et aux visions différenciées qui en découlent, le propos n’est pas ici de prendre parti ni de prolonger la discussion. Il ne s’agit donc pas de répondre à la question de savoir à laquelle des trois collectivités territoriales le législateur devrait accorder le monopole d’être le territoire de référence en matière de proximité. Ce que propose cette contribution consiste plutôt à appréhender les collectivités territoriales comme de vraies actrices de la fabrique institutionnelle de la proximité, au-delà de leurs cadres réglementaires respectifs. Cette posture fait écho à l’approche de Talbot (2008) relative aux « institutions créatrices de proximité ». À ce titre, elle rejoint directement les considérations de Lebrun (2023, p.3) qui indiquent que « la proximité est choix. Le choix, volontaire ou non de mobiliser tel ou tel type de proximité […]. Il relève de la proxémie. La proxémie, ce besoin impérieux, de faire du tri conscient et inconscient dans nos usages de l’espace, nous amène à hiérarchiser, de façon mouvante et incessante, le rapport à nos proximités ».
Ainsi, à partir d’une enquête[1] en 2020 auprès de cadres administratifs et d’élus de deux conseils départementaux, Isère et Meurthe-et-Moselle, cet article s’attache à analyser le projet et l’agir de la collectivité départementale en matière de proximité. En effet, dans un souci de conduire leurs compétences transférées, en particulier leurs politiques sociales au plus près des territoires et des publics, ces deux Départements ont progressivement développé une organisation territorialisée de leurs services. Mais, après une vingtaine d’années de territorialisation de leurs politiques publiques départementales au nom de l’enjeu de la gestion de proximité, une question principale se pose : C’est quoi incarner et/ou faire la proximité pour un Département, aussi bien en termes d’implantation territoriale que d’organisation des services ?Les résultats de l’étude révèlent que les processus respectifs suivis par chacun des deux Départements étudiés ne sont pas linéaires. Au contraire, selon les présidences successives ou les alternances politiques au niveau de l’exécutif départemental ou selon les différentes réformes territoriales qui se sont suivies, le mouvement s’est avéré plutôt tâtonnant, tergiversant entre une dynamique centrifuge (I) et une logique centripète (II).
1 . Un travail politico-administratif permanent de redéfinition des territoires supports de la proximité départementale
Des deux départements étudiés, la Meurthe-et-Moselle est le premier à avoir initié un projet de réorganisation administrative de ses services par secteur territorialisé, animé par le souci de proximité avec les publics et les partenaires locaux. Un cadre interrogé nous décrit le contexte de départ du projet : « La politique territoriale a été posée comme une orientation politique inscrite dans la campagne cantonale de 1997/1998 portée par Michel Dinet, à l’époque conseiller général d’opposition, et son équipe. Elle est constituante du projet politique qu’il portait et avec lequel il a obtenu la majorité des suffrages en mars 1998. Cette majorité plurielle de gauche, Ecologie, PS, Front de gauche, est restée inchangée jusqu’à ce jour » [extrait d’entretien du 13/02/2020 avec Cadre 1 du CD 54]. Dans la même logique, un ancien conseiller général précise la vision sur laquelle a reposé le projet de Dinet. Selon lui : « aux yeux de Michel Dinet, le Département apparaissait encore comme une institution trop notabilitaire. Il disait même que c’était l’institution pré-sénatoriale. Son projet est parti du constat d’une démocratie représentative déjà malade, pas suffisamment capable de répondre au défi de l’inclusion des citoyens dans la décision publique. Ainsi, il s’est basé sur la philosophie du développement des territoires des lois Voynet de juin 1999 et Chevènement de juillet 1999 pour construire son projet départemental » [extrait d’entretien du 28/12/2020 avec ancien élu du CD 54].
Pour matérialiser le projet, l’exécutif départemental, appuyé par les équipes de Denis Vallance, directeur général des services de 2001 à 2015, a regroupé et réorganisé les services de solidarité, de ressources, et de soutien aux territoires en six territoires : Briey, Grand Nancy, Longwy, Lunévillois, Terres de Lorraine et Val de Lorraine. Ces nouveaux territoires censés devenir les lieux de la gestion de proximité et de la co-construction de l’action publique entre le Département, les communes et EPCI concernés, les représentants de parents d’élève, de l’éducation nationale, des associations médico-sociales, des habitants et autres parties prenantes ont été découpés suivant la logique des intercommunalités et pas des cantons.
Avec l’élection en 2015 de Mathieu Klein comme nouveau président du Conseil département avec la même majorité de gauche plurielle, l’organisation territorialisée du département autour de six territoires structurés chacun autour d’une Maison départementale connait quelques adaptations. Dix-sept Maisons des solidarités sont créées en 2015 dans les six territoires en raison de deux par territoire à l’exception du Grand Nancy qui en accueille et Lunévillois, territoire le plus rural, qui en obtient trois.
Dans le Département de l’Isère, le projet d’expérimenter une politique territoriale de l’action publique, en lieu et place de l’ancienne logique d’organisation des services départementaux par métiers, a aussi été initié avec l’arrivée d’un président d’une majorité de gauche, André Vallini qui a dirigé l’exécutif de mars 2001 à juin 2014. Comme dans la Meurthe-et-Moselle, le Département a été découpé en différentes zones dont les critères suivent « une logique de bassin de vie c’est-à-dire par périmètre d’intercommunalités. Au début des années 2000, il y avait une trentaine d’intercommunalités, et le département avait décidé de faire 13 territoires, en regroupant dans certains territoires 2 à 3 intercommunalités » [extrait d’entretien du 11/02/ 2020 avec un DGA du CD 38].
Une autre particularité de l’Isère est que « le vrai impulseur du projet n’était pas Vallini mais Marc Baïetto son Vice-président de l’époque en charge de l’organisation du territoire et des transports de 2001 à 2010, appuyé par Thierry Vignon qui était DGS de 2004 à 215. Baïetto avait une vraie volonté d’avoir des projets structurants de proximité. Il souhaitait que les territoires fassent émerger des projets avec de l’aide à l’investissement décidée par les conseillers généraux du territoire en fonction de leurs problématiques spécifiques et des disparités territoriales » extrait d’entretien du 15/09/ 2020 avec Cadre 2 du CD 38].
2. Un travail politico-administratif permanent de redéfinition du contenu de la proximité départementale
Si l’élection de Jean-Pierre Barbier depuis 2015 comme nouveau président du conseil départemental de l’Isère, avec une majorité de droite le « Mouvement pour l’Isère » ne remet pas en cause le principe de l’organisation territorialisée de la proximité décidée par son prédécesseur, à part un ajustement du périmètre du territoire de l’agglomération grenobloise compte tenu de la création de la Grenoble-Alpes-Métropole, des changements dans le fond sont intervenants. Ils s’inscrivent dans son projet « Territoire de demain » qui décide, entre autres : du changement d’appellations des 13 maisons de territoires désormais dénommées les Maisons départementales pour une « meilleure identification de la présence territoriale locale du département, gage de proximité et de réactivité », de la recentralisation au siège départemental des fonctions supports (finance et RH), la mise en place de Conférences territoriales de solidarité – CTS pour réunir dans chacun des 13 territoires 2 à 3 fois par an les maires, les présidents de CCAS, les responsables des services sociaux.
En Meurthe-et-Moselle, sous la présidence Mathieu Klein, la fonction de Vice-président territorial a été supprimée et remplacée par de simples des délégués territoriaux car « on avait constaté que l’une des dérives possibles du projet de nos prédécesseurs étaient d’aboutir à de mini-présidence départementale avec beaucoup de pouvoir au sein de leurs territoires respectifs », indique un élu. De même, d’autres raisons ont été invoquées, comme l’augmentation des compétences obligatoires depuis 2004, l’accroissement des bénéficiaires du RSA pour justifier le redimensionnement de la politique territoriale précédente d’un point de vue financier. Ainsi, les 17 maisons des solidarités se voient assignées pour mission de regrouper et de réorganiser les services de solidarité dans l’objectif de « permettre plus de proximité avec les usagers, plus de proximité entre les travailleurs sociaux de l’aide social à l’enfance, les sages femmes, les médecins de la protection maternelle et plus de proximité du département avec les spécificités et les dynamiques de territoires, tout en essayant de maîtriser les coûts », tel que nous l’explique un directeur de territoire.
Conclusion
Les enseignements majeurs de cette étude sur les politiques territorialisées de deux Départements déployées depuis une vingtaine d’années dans un objectif affiché de recherche de proximité peuvent être au moins de trois types. D’abord, on s’aperçoit que la proximité dont il question dans les deux départements semble sélective, elle ne s’applique qu’à certains échelons spécifiques et ne vise donc pas l’ubiquité (Le Bart, 2005). Elle évite notamment de recourir à des territoires comme le canton, pourtant circonscription électorale des conseillers départementaux. La crainte de les voir devenir de « mini-féodalités » à force de trop déléguer ou de trop renforcer les pouvoirs de leurs élus respectifs était un argument récurrent lors de nos entretiens. Ensuite, la proximité dont il semble question pour les deux Départements se présente comme un moyen de développement et de légitimation institutionnels de la collectivité départementale dont la présence dans les territoires locaux recherche aussi à accroître sa visibilité et sa reconnaissance dans un contexte où il convient de trouver sa place parmi d’autres types de collectivités territoriales. Enfin, si les processus observés de mise en place de la proximité départementale paraissent parfois empruntés des directions ou des dynamiques partagées entre logiques décentralisatrices et re-centralisatrices, nous les abordons ici non pas comme quelque chose de contradictoire mais bien comme la preuve d’une démarche vivante et d’un ajustement sélectif permanant. Ainsi, avec le développement progressif de l’e-administration qui n’épargne pas les Départements, d’autres ajustements sont sans doute à attendre dans le travail politico-administratif de quête, de construction et de redéfinition de la proximité de l’institution départementale.
Références bibliographiques :
Estèbe, P., 2015, L’égalité des territoires, une passion française, Paris, PUF, « La Ville en débat »
FranceArchives, 2023, Les départements : la juste proximité depuis 230 ans, 23 août, https://francearchives.gouv.fr/fr/article/256318841
Guerrin, J. 2021, « Ce qui compte, c’est d’agir à la bonne échelle ». In Barbier, R. et Hamman P.(dir.), La fabrique contemporaine des territoires, Paris, Le Cavalier Bleu, p.55-61
Lebrun, N., 2023, « Pour une conscience de proximité(s) », 0 | – Ma proximité, GéoProximitéS, https://geoproximites.fr/ark:/84480/2023/09/09/pour-une-conscience-de-proximites/
Le Bart, C., 2005, « 7. Métier politique et ubiquité : l’art d’être là ». In Le Bart, C. et Lefebvre, R. (éd.), La proximité en politique, PUR, https://doi.org/10.4000/books.pur.9702.
Ozouf-Marignier, M.-V., 1990, « La formation des départements ». In : Géographes associés n°8. De la France des départements à l’Europe des régions. Géoforum Nantes 89. p.11-14
Sénat, 2020, Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements, Rapport d’information n°706 (2019-2020), de Mme Cécile Cukierman, fait au nom de la MI, déposé le 15 décembre
Talbot, D., 2008, « Les institutions créatrices de proximités. Institutions as creators of proximities », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, vol. , no. 3, pp. 289-310.
Thomas, O. 2015, « Peut-on justifier la suppression des départements français ? Une revue de la littérature », Revue française d’administration publique, vol. 154, no. 2, 2015, pp. 505-522.
[1] Dans le cadre d’une étude financée par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine sur la territorialisation de l’action départementale dans six départements : Côtes-d’Armor (22), Ille-et-Vilaine (35), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Meurthe-et-Moselle (54) et Rhône (69).
Pour citer cet article :
DIATTA Patrice, « La proximité comme projet départemental : un ajustement sélectif permanent », 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-ac12/