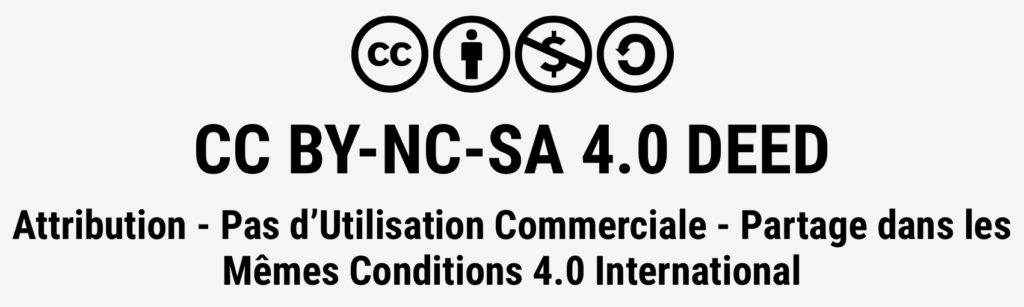Taking care of women entrepreneurs in deprived areas ? Supporting business in Politique de la ville
Loréna Clément
〉Maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme
〉Université Sorbonne Paris Nord
〉UR Pléiade
〉lorena.clement@laposte.net 〉
〉Article long 〉
Télécharger l'article. 2-2024 Clément
Résumé : Alors que l’entrepreneuriat féminin est politiquement soutenu à différentes échelles, des associations aident des femmes à créer leur activité en quartier prioritaire (QP). Les conseiller·e·s à l’entrepreneuriat cherchent à renforcer leurs capacités d’action dans un contexte genré et territorial inégalitaire. Peut-on alors considérer cet accompagnement comme une forme de care ? Cette question invite à modifier le regard sur l’entrepreneuriat et sur les QP, en examinant des pratiques micro-locales de soutien grâce à une enquête de terrain menée auprès d’associations agissant à Plaine Commune et Nantes Métropole qui mobilise des méthodes qualitatives. Les résultats montrent que les expériences entrepreneuriales et spatiales des femmes en QP sont structurées par des inégalités de genre. Les structures d’accompagnement à la création d’activité cherchent à les réduire en renforçant l’autonomie et la légitimité de ces femmes à entreprendre. Si leurs pratiques de soutien ont des effets au niveau individuel, elles ne transforment pas les rapports genrés inégalitaires.
Mots-clés : accompagnement, care, entrepreneuriat féminin, inégalités, politique de la ville.
Abstract: When women’s entrepreneurship is receiving political support from international to local scale, some associations are helping women to set up their own business in disadvantaged neighbourhoods. Entrepreneurship advisors seek to strengthen their capacity for action in a gendered and unequal territorial context. Is this support a form of care ? This question invites us to change the way we look at entrepreneurship and disadvantaged neighbourhoods, by examining micro-local practices of care through a field survey of entrepreneurship support associations operating in Plaine Commune and Nantes Métropole, that uses qualitative methods. The results show that the entrepreneurial and spatial experiences of women in disadvantaged neighbourhoods are structured by gender inequalities. Business support structures aim to reduce these inequalities by reinforcing the autonomy and entrepreneurial legitimacy of these women. While their care practices have an impact at individual level, they do not transform unequal gender relations.
Keywords: business support, care, inequalities, politique de la ville, women’s entrepreneurship.
Introduction
Premières, Action’elles, Femmes des territoires, Girlz in web, StartHer, Femmes entrepreneures, Women Business Mentoring Initiative, Femme Business Angels, Force femmes conseils… De nombreux réseaux spécialisés à destination des femmes entrepreneuses[1] existent en France aujourd’hui, dans un contexte de politique nationale en faveur de l’entrepreneuriat féminin. La politique française s’inscrit dans un contexte européen et international plus large, qui préconise la mise en œuvre de dispositifs de discrimination positive affermissant la position des femmes sur le marché du travail. La création d’entreprise devient un outil de lutte contre la pauvreté et de renforcement des capacités d’action des femmes dans les territoires précarisés[2].
La politique d’encouragement à l’entrepreneuriat féminin se décline dans des territoires, notamment les quartiers prioritaires (QP). Ceux-ci désignent les espaces les plus pauvres de France où l’Etat déploie des moyens spécifiques pour rattraper leur prétendu retard. Les textes interministériels[3] y ciblent des profils à accompagner, notamment les femmes, car elles y sont généralement plus exposées au chômage que les hommes : en QP, 40,2 % des femmes en âge de travailler sont actives contre 51,4 % des hommes. Parmi elles, 22,3 % sont au chômage contre 9,1 % des femmes des unités urbaines environnantes. En outre, elles y sont davantage concernées par le sous-emploi que leurs homologues masculins : 16,6 % travaillent à temps partiel contre 5,6 % des hommes en QP (CGET, ONPV, 2019). Ainsi, l’aide à l’entrepreneuriat des femmes en QP est considéré par l’Etat comme un moyen de remédier au chômage en créant son activité. Dans ce cadre, il s’agit d’améliorer leur accès aux ressources qui favorisent le développement d’une entreprise[4] alors que des inégalités territoriales et de genre structurent leur démarche entrepreneuriale. D’après les données issues d’enquêtes de la Banque publique d’investissement (BPI), les entrepreneuses représentent 3 % de la population féminine active en QP alors qu’elles en représentent 7,3 % à l’échelle nationale. En politique de la ville, 30 % des créateur·rices d’entreprise sont des femmes quand 70 % sont des hommes. Dans ce contexte genré inégalitaire, l’Agence France Entrepreneur propose en 2014 « 7 engagements pour améliorer l’accompagnement des créatrices d’entreprise dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
L’encouragement à l’entrepreneuriat féminin s’inscrit dans une politique plus globale d’aide à la création d’entreprise en QP et de réduction des inégalités sociales, économiques et urbaines entre les 1514 quartiers les plus pauvres de France et leur territoire environnant, nommée la politique de la ville. Cette dernière peut être considérée comme une politique publique nationale de réparation des territoires dits « fragiles »[5]. Des financements et des actions spécifiques sont mis en œuvre dans des domaines variés comme la rénovation urbaine, l’éducation, la santé ou l’emploi pour rétablir un équilibre territorial en prenant soin des habitant·es des QP, qui regroupent 5,5 millions de personnes, soit 8 % de la population nationale. Le soutien à la création d’activité en QP est l’une des mesures présentes dans la réforme de la politique de la ville de 2014[6]. Il s’agit d’améliorer l’accès de l’ensemble des habitant·es des QP à l’entrepreneuriat car celui-ci serait un facteur d’égalité des chances et d’ascension sociale : tout le monde pourrait créer un entreprise prospère tant qu’iel en a la volonté. Or, les QP sont peu pourvus en établissements économiques, ce qui freine les opportunités commerciales des entrepreneur·ses endogènes. En 2018, on compte 40 établissements à caractère économique pour 1 000 habitant·es de QP contre 78 dans les unités urbaines englobantes (CGET, ONPV, 2019). Dans ce contexte territorial inégalitaire, le président François Hollande a lancé en 2013 le plan « Entrepreneurs des quartiers » pendant les Assises nationales de l’entrepreneuriat. Les structures d’accompagnement à la création d’activité sont incitées à y agir pour aider les habitant·es à développer leur projet d’entreprise.
Alors que le discours commun promeut l’avènement d’une société méritocratique grâce à l’entrepreneuriat, l’article analyse la mise en œuvre de cette action publique territoriale en interrogeant ses effets sur les femmes accompagnées en QP. Il se demande ainsi en quoi elle réduirait les inégalités genrées et spatiales qui structurent l’entrepreneuriat. Pour ce faire, il déploie un angle d’approche particulier en mobilisant la notion de care :si des dispositifs entrepreneuriaux sont censés soutenir les femmes à renforcer leurs capacités d’action en réduisant les inégalités présentes, peut-on y voir des formes de soin accordées aux entrepreneuses par les conseiller·es ? Cette question peut sembler déplacée car la création d’activité est surtout affiliée à des logiques de développement économique fondées sur la croissance et la rentabilité (Gauthier, 2020 ; De Sa Mello da Costa & Silva Saraiva, 2012 ; Perren & Jennings, 2005). Pour autant, une enquête de terrain montre que les pratiques des conseiller·es à l’entrepreneuriat rencontré·es sont aussi motivées par la bienveillance et l’aide à autrui. Plus qu’à créer des entreprises, iels cherchent à améliorer les conditions d’existence d’individus en répondant à leurs besoins.
Cette enquête a été menée dans des associations qui accompagnent des entrepreneur·ses implanté·es dans les QP de Nantes Métropole et de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis. Elle repose sur des entretiens, des observations d’événements et des analyses de documents produits par les acteur·rices rencontré·es. Elle permet d’examiner si et en quoi l’aide à l’entrepreneuriat prend soin de femmes installées dans des territoires socio-économiquement précaires pour réduire les inégalités dont elles font l’objet. Cette question sous-tend trois enjeux. D’abord, elle invite à modifier le regard commun négatif porté sur les QP en examinant les pratiques de soin qui s’y déploient, plutôt que les pratiques d’insécurité ou de violence. Ensuite, elle invite à redessiner l’action publique à partir de pratiques micro-locales visant le bien-être des individus, en donnant à voir des formes déjà là de care. Enfin, elle invite à appréhender des spécificités de la politique de la ville dans la mise en œuvre de telles pratiques.
L’approche méthodologique et les terrains choisis sont détaillés dans une deuxième partie, après un premier temps consacré au cadre théorique mobilisé. Les trois dernières parties de l’article sont quant à elles dédiées à l’analyse. D’abord, j’y expose en quoi les expériences entrepreneuriales et spatiales des femmes en QP sont structurées par des inégalités de genre : leur fonction de mère et leur sentiment d’illégitimité en tant que femme réduisent généralement le déploiement de leur activité. Ensuite, je montre en quoi les structures d’accompagnement à la création d’activité cherchent à réduire ces inégalités en prenant soin des femmes qu’elles accueillent : elles multiplient les événements qui leur sont dédiés en s’adaptant à leurs besoins pour accroître leur légitimité à entreprendre. Enfin, j’explique que les pratiques de soin des conseiller·es augmentent les capacités d’action des entrepreneuses sans transformer les rapports genrés inégalitaires : malgré une partielle conscientisation collective, le monde entrepreneurial reste structuré par des normes androcentrées. Finalement, je conclus en invitant à redéfinir l’entrepreneuriat et l’action publique territoriale selon une perspective féministe, en plaçant l’objectif et la pratique du care au centre de l’organisation sociétale et des politiques publiques urbaines pour atteindre un monde plus juste.
1. Le care, une notion pour réimaginer la politique de la ville à l’aune des pratiques micro-locales de soin dans l’aide à la création d’activité en QP
Le présent article participe à combler le manque de connaissances sur l’entrepreneuriat en politique de la ville, en l’attaquant sous un angle particulier : la présence du care dans le soutien à la création d’activité des femmes implantées en QP pour réduire les inégalités dont elles font l’objet. En appréhendant les dimensions humaines, relationnelles et appliquées qui s’y jouent, l’article dépasse la conception traditionnelle de l’égalité présente dans la politique de la ville, conçue d’abord sur la distribution spatiale des ressources, et la conception commune de la création d’entreprise, conçue d’abord sur des logiques de développement économique.
Depuis une trentaine d’années, des philosophes et des sociologues utilisent la notion de care pour valoriser une forme de rapport au monde en contexte de vulnérabilité. Dans son ouvrage de référence, la psychologue américaine Carol Gilligan (1982) change de rapport à l’éthique de la justice en mobilisant le care. Elle remet en cause l’idée d’une justice universelle qui s’appuie sur une rationalité abstraite pour proposer une justice sensible au soin d’autres concrets, fondée sur l’expérience et des rapports humains singuliers. Après ce travail fondateur, l’éthique du care s’est diffusée en sociologie et en philosophie politique depuis les années 2000. La politologue états-unienne Joan Tronto et sa collègue Berenice Fischer (1991) la définissent comme « une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (p.40). Le care désigne ainsi les activités d’êtres humains qui s’engagent dans un souci d’autrui et de la vie. Joan Tronto (2009 ; 2013) en distingue cinq phases : « se soucier de » fait le constat d’un besoin et évalue la possibilité d’y apporter une réponse ; « se charger de » implique d’agir dans le processus de soin en assumant une responsabilité vis-à-vis du besoin constaté ; « accorder des soins » met en contact les receveur·ses et les donneur·ses du soin qui produisent un travail matériel ; « recevoir des soins » correspond à la réaction des receveur·ses en fonction de la réalisation de leurs besoins ; « prendre soin avec » s’inscrit dans un cadre plus large en prenant en compte la façon dont les activités de care devraient être effectuées et organisées dans la société.
Outre les travaux de philosophie et de sociologie, un pan de la géographie anglophone s’est emparé du concept de care (Milligan & Wiles, 2010 ; Conradson, 2003). Des recherches étudient des lieux qui rendent possibles des interactions fondées sur le soin ; certaines analysent les jeux d’échelle du care en examinant les relations d’interdépendance qui existent à l’échelle internationale, les contextes nationaux qui influencent leurs modalités de déploiement, ou encore les liens interpersonnels locaux qui structurent le quotidien des individus ; d’autres élaborent des méthodologies propices au care en valorisant les émotions et une relation plus horizontale aux personnes enquêtées. Pour certain⸱es chercheurs⸱ses, les géographes ont en effet une responsabilité éthique à repenser leur travail à partir du care (Lawson, 2007). Il s’agit également d’examiner les inégalités plurielles qui traversent l’organisation du care dans nos sociétés, en mobilisant notamment une approche intersectionnelle qui rend compte de l’imbrication des dominations. Comme le rappelle la philosophe Helena Hirata (2021, p.38), le care est « un travail matériel, technique et émotionnel qui est façonné par des rapports sociaux de sexe, de classe, de “race”/ethnie, entre différents protagonistes ». En France, le concept de carecommence à percoler les recherches en géographie (Luxembourg & Noûs, 2022 ; Lussault, 2018). Par exemple, Claire Tollis (2013) étudie la spatialisation des actes de soin pratiqués dans la gestion des espaces de nature. Les théories du care lui permettent de dresser une géographie relationnelle des espaces protégés qui sont entretenus grâce à des réseaux de relations.
L’extension de ce que désigne le « travail du care » fait l’objet de débats entre les chercheuses. Les aides-soignantes et professions assimilées, les aides à domicile et ménagères, les infirmières et assimilées, les gardiennes d’enfants sont les activités professionnelles communément regroupées sous l’expression de « travail du care ». Pour autant, l’attitude attentionnée qui existe dans une pluralité de métiers des services à la personne invite à étendre cette expression, notamment aux métiers de l’entrepreneuriat. Les affects que les conseiller·es à la création d’activité investissent dans leur relation aux entrepreneur·ses et ceux que ces dernier·es investissent dans leur projet d’activité questionnent l’appartenance de leurs métiers à la définition élargie du travail du care. En effet, les conseiller·es semblent prendre soin de femmes pour améliorer leurs conditions d’existence dans le cadre d’une politique de la ville censée « réparer » des quartiers « fragiles ». L’utilisation du concept de care permet alors d’appréhender ces relations d’interdépendance en analysant les pratiques relationnelles de soin octroyées par des conseiller·es concerné·es par autrui.
Toutefois, la présence du care dans le soutien en entrepreneuriat en QP n’a pas encore été étudiée. D’une part, la création d’activité en politique de la ville constitue un objet d’étude interdisciplinaire récent qui reste peu traité par les chercheur·ses en études urbaines. Ces dernier·es investiguent surtout les politiques de logement, la rénovation urbaine, les processus de politisation et/ou de participation en politique de la ville. Même si la Revue économique a consacré un numéro à l’« Économie des quartiers prioritaires » en 2016[7], les travaux universitaires consacrés au développement économique en QP sont largement minoritaires. Lorsque le champ économique est pris en compte, il est abordé sous l’angle du chômage, de la mobilité à l’emploi ou des zones franches urbaines : l’entrepreneuriat n’apparaît pas, ou très peu[8]. Quelques thèses récentes en aménagement-urbanisme analysent cependant l’ancrage des entreprises (Hercule, 2022) ou l’accès et les effets restreints de la politique de soutien à l’entrepreneuriat en QP (Clément, 2022).
D’autre part, les recherches en entrepreneuriat s’intéressent peu à ces territoires. De rares chercheuses en sciences de gestion dressent un état des lieux partiel de l’entrepreneuriat féminin en QP, en ciblant certaines régions et publics. Par exemple, une enquête menée dans la métropole Aix-Marseille-Provence cherche à savoir s’il est possible d’atteindre 40 % de femmes parmi les créateur·rices d’entreprise résidant en zones urbaines sensibles (ZUS)[9] en 2017 (Van de Walle & Aldeghi, 2015). Une autre enquête suit un dispositif d’accompagnement à l’entrepreneuriat social mis en place par l’école des Hautes études commerciales (HEC) à destination des femmes vivant dans la cité des 4000 à la Courneuve, un QP en Seine-Saint-Denis (Notais & Tixier, 2018). Ce travail met en valeur des profils et des pratiques entrepreneuriaux qui s’écartent de l’image canonique de l’entrepreneur homme, occidental et diplômé qui cherche la croissance et le profit (Ogbor, 2000).
Or, depuis les années 2000, des chercheuses entendent valoriser la pluralité de ces profils, pratiques et représentations entrepreneuriales pour visibiliser celles des publics discriminés dont les femmes font partie. En adoptant une perspective genrée, plusieurs travaux de sciences de gestion montrent que le genre est une construction sociale qui oriente les représentations et les actions entrepreneuriales qui l’influencent en retour (Bruni & al., 2004). Par exemple, les entrepreneuses sont souvent moins motivées par la performance économique que par des aspirations personnelles (Boring, 2016) ; elles accordent plus de place aux relations sociales et à l’équilibre familial que leurs homologues masculins (D’Andria & Gabarret, 2016). Des chercheuses révèlent ainsi l’androcentrisme qui caractérise la création d’activité et s’opposent à la figure construite masculine de l’homo oeconomicus (Marlow & Martinez Dy, 2018). Cette figure instituée participe à délégitimer les femmes qui ne s’y reconnaissent pas (Pailot et al., 2015). Une enquête par questionnaire menée auprès d’étudiant·es en commerce aux États-Unis, en Inde et en Turquie montre que les stéréotypes de genre influencent les intentions entrepreneuriales des hommes et des femmes au détriment de celles-ci (Gupta et al., 2009). Les étudiant·es définissent l’entrepreneuriat à partir de caractéristiques assimilées au genre masculin comme le goût de l’aventure et de la performance, la prise de risque, la combativité, etc. Ces représentations limitent les intentions d’entreprendre des personnes de genre féminin qui se sentent illégitimes. Cette illégitimité à créer une activité est aussi diffusée par des acteur·rices institutionnel·les qui l’entretiennent en contraignant l’accès des femmes aux ressources pour entreprendre.
Dans ce cadre entrepreneurial genré et inégalitaire, des chercheur·ses examinent les formes d’accompagnement à la création d’activité qui répondent aux besoins des entrepreneuses. Au cours des années 2010, le soutien à l’entrepreneuriat est passé « très rapidement d’un statut anecdotique à celui d’un véritable champ de recherche » (Chabaud et al., 2010, p.1). L’adaptation de l’accompagnement à des publics spécifiques, dont l’hétérogénéité s’est accrue avec la création du statut de la micro-entreprise en 2015, constitue un enjeu pour la profession. Des recherches sont dédiées au soutien des entrepreneur·ses immigré·es (Levy-Tadjine, 2004), des entrepreneur·ses contraint·es (Couteret, 2010) ou des entrepreneuses (Santoni, 2018 ; Lebègue, 2015). En 2020, la publication de l’ouvrage Déconstruire les mythes pour mieux accompagner une diversité d’entrepreneuses (Tremblay et al) révèle l’actualité de cette thématique.
Si certains travaux décrivent des postures de conseiller·es qui relèvent parfois du care, telles que l’« escorteur » qui écoute et soutient psychologiquement les personnes qu’iel accompagne (Verzat & Gaujart, 2009), ils ne mentionnent ni n’appréhendent les pratiques d’aide à l’entrepreneuriat à l’aune de ce concept. Il en va de même des travaux sur l’entrepreneuriat féminin. Certains montrent l’importance que les entrepreneuses confèrent à leur famille et à leurs émotions dans leur activité économique, mais ne l’articulent pas à l’enjeu du care.
Cette absence d’utilisation du concept de care rappelle à quel point celui-ci est encore loin de constituer un cadre commun pour comprendre l’organisation sociétale et construire des politiques publiques. D’où l’intérêt du présent article d’appréhender son existence dans le soutien à l’entrepreneuriat en QP, en questionnant sa pertinence à lutter contre les inégalités territoriales et genrées qui s’y déploient. Cet angle d’approche vise par là à changer le regard sur les QP, souvent désignés médiatiquement par leur insécurité et leur violence, et à renouveler la manière de penser l’action publique territoriale, en partant des expériences sensibles des acteur·rices locaux·ales que sont les conseiller·es et les entrepreneur·ses.
2. Une étude qualitative dans deux terrains d’enquête
Les réflexions qui nourrissent cet article sont issues d’une enquête de terrain de 18 mois[10] menée auprès d’associations qui aident les personnes implantées en QP à créer leur entreprise. L’enquête permet de confronter les objectifs des acteur·rices politiques nationaux·ales aux expériences des acteur·rices locaux·ales, que ce soit des élu·e·s, des conseiller·e·s à l’entrepreneuriat ou des entrepreneur·ses accompagné·es. Les associations investiguées se situent dans deux intercommunalités, l’une en première couronne francilienne et l’autre en agglomération nantaise. Elles se composent de conseiller·es qui proposent des entretiens individuels à toute personne motivée qui développe un projet d’activité et qui est localisée dans leur territoire d’action. Durant ces entretiens individuels, les conseiller·es abordent l’étude de marché, les statuts juridiques de l’entreprise, la prospection commerciale, etc. Par ailleurs, iels organisent des événements collectifs pour informer, apporter des connaissances et mettre en réseau les personnes qu’iels accompagnent. Le premier terrain cible l’association nommée la Maison de l’initiative économique locale (Miel), créée en 1998 par des élu·es locaux·ales pour favoriser le développement économique endogène en soutenant les initiatives entrepreneuriales locales. Composée de 5 conseiller·es, la Miel aide les entrepreneur·ses implanté·es dans l’intercommunalité de Plaine Commune à développer leur activité. Si elle ne restreint pas son action au périmètre des QP, ceux-ci représentent 68 % de la superficie et 65 % des habitant·es de Plaine Commune. Les taux de chômage et de pauvreté y dépassent respectivement 18 % et 35 %. En 2018, les conseiller·es de la Miel ont accompagné 173 porteur·ses de projet et 56 entrepreneur·ses en post-création. Créé en 2013 par l’Intercommunalité Nantes Métropole, le dispositif « Osez entreprendre » constitue le second terrain d’enquête. Composé de deux structures d’accompagnement, de deux structures de financement et de maisons de l’emploi, il accompagne les entrepreneur·ses des 15 QP de l’agglomération nantaise qui représentent 10 % de sa population. Dans ces territoires, les taux de chômage et de pauvreté dépassent les 15 % et 30 %. En 2019, Osez entreprendre a aidé 110 individus à créer une entreprise et 97 à en développer une.
Depuis la fin des années 2010, les femmes sont surreprésentées dans le public accompagné par la Miel et Osez entreprendre. Les femmes constituent 20 % du public de la Miel en 2004, 40 % en 2017 et 53 % en 2018. A Osez Entreprendre, elles correspondent à 49 % des personnes suivies en 2018 et à 53 % en 2019[11]. Ce processus de féminisation détone dans un contexte où les entrepreneuses en QP sont sous-représentées comme catégorie professionnelle. Il rejoint toutefois une tendance nationale : si les femmes entreprennent moins que les hommes, elles sont proportionnellement plus accompagnées. En effet, elles ne représentent que 30 % des créations annuelles d’entreprises mais 39 % à 45 % du public des structures qui aident à la création et au développement d’activité (Van de Walle & Aldeghi, 2015). Plusieurs causes expliquent cette féminisation de l’accompagnement à l’entrepreneuriat. D’une part, le sentiment d’illégitimité des femmes conduit celles-ci à chercher plus d’écoute et de soutien que les hommes. D’autre part, les prérogatives gouvernementales incitent les structures d’accompagnement à cibler les femmes en finançant des actions qui leur sont destinées. Dans ce contexte de surreprésentation féminine, la Miel et Osez entreprendre constituent deux objets d’étude pertinents pour analyser les pratiques de soin accordées aux entrepreneuses par les conseiller·es et leurs effets sur les inégalités genrées à entreprendre en QP.
Par ailleurs, la Miel et Osez entreprendre sont intéressants en ce que leur expérience en QP est ancienne et qu’elle est soutenue politiquement. Le tableau ci-dessous donne des informations quant aux relations de dépendance que ces structures entretiennent avec les pouvoirs publics, qui sont leurs initiateurs, leurs principaux financeurs et des membres de leur conseil d’administration. Leur position vis-à-vis des acteur·rices public·ques locaux·ales influence leurs objectifs et leurs actions destinées aux entrepreneuses en QP, sur lesquels je reviendrai au fil de la présentation des résultats.
| Nom de la structure | La Miel | Osez entreprendre |
| Statut | Association | Regroupement d’associations |
| Date de création | 1998 | 2013 |
| Initiateur·rices | Élu·es locaux·ales intercommunaux·ales | Nantes Métropole |
| Objectifs | Soutenir les initiatives locales en faveur d’un développement économique endogène | Favoriser l’insertion socio-professionnelle |
| Financeur·ses | Surtout des institutions publiques (plus de 60 % du budget en 2018) : d’abord l’Intercommunalité (57 % des subventions publiques), puis l’Union européenne (15 %), la Région (11 %), le Département (8 %), la Caisse des dépôts et consignations (CDC, 3 %) et l’État | Surtout des institutions publiques (plus de 65 % du budget en 2018) : d’abord la BPI (28 % du budget total), puis l’Intercommunalité (25 %), la CDC (25 %) et l’État (14 %) |
| Fonctionnement | Cinq conseiller·es proposent des entretiens individuels aux entrepreneur·sesFormations collectives (souvent données par des intervenant·es extérieur·es) | Les maisons de l’emploi accueillent et orientent les entrepreneur·ses vers deux structures d’accompagnement et deux structures de financement qui leur proposent des rendez-vous individuels et des formations collectives |
| Lieu d’action | L’intercommunalité de Plaine Commune dont 70 % de sa superficie et de ses habitant·es sont en QP | Les QP de l’intercommunalité de Nantes Métropole |
La Miel et Osez entreprendre ne sont pour autant pas représentatives de l’ensemble des structures d’accompagnement présentes en QP, certaines ciblant davantage les projets entrepreneuriaux à fort potentiel de développement. Si les caractéristiques des personnes que la Miel et Osez Entreprendre aident sont variées, beaucoup sont d’origine étrangère, détentrices d’aucun diplôme ou inférieur au baccalauréat, femmes. Elles montent principalement des très petites entreprises sous le statut de la micro-entreprise ou de la société par actions simplifiées, de taille et de financement réduits, qui relèvent des secteurs traditionnels fondés sur un savoir-faire, et qui sont peu rémunératrices. Il s’agit principalement d’activités de vente, de services à la personne, de restauration, de bâtiments et travaux publics, et de véhicule de tourisme à la personne. Concernant les conseiller·es, leurs profils sont marqués par des parcours personnels et professionnels divers. Âgé·e·s entre 25 et 45 ans, autant femmes qu’hommes, leur ancienneté dans le travail d’accompagnement à la création d’activité est très variable : certain·es débutent, se reconvertissent, ou y agissent depuis plus de 10 ans. Si les plus jeunes sont souvent issu·es d’écoles de commerce ou de masters spécialisés en économie sociale, les plus ancien·nes ont des parcours de formation hybrides : administration de compagnie culturelle, secrétariat, analyse financière, etc. Les conseiller·es enquêté·es possèdent par ailleurs une expérience variable des QP : certain·es y ont grandi et/ou y vivent tandis que d’autres viennent de les découvrir.
J’ai employé des méthodes qualitatives pour investiguer ces terrains. J’ai mené des entretiens avec deux types d’acteur·rices : 63 entretiens avec des acteur·rices institutionnel·les et 50 entretiens avec des entrepreneur·ses. Ils permettent d’étudier leurs intentions, leurs représentations et leurs pratiques entrepreneuriales et révèlent l’influence du genre sur ces expériences. Les acteur·rices institutionnel·les recouvrent des profils divers : acteur·rices politiques qui orientent les stratégies d’accompagnement, acteur·rices administratif·ves qui les diffusent, acteur·rices associatif·ves qui les appliquent. Sur les 63 entretiens, 10 ont été conduits avec les membres de la Miel, 9 avec les membres d’Osez entreprendre, 31 avec des acteur·rices institutionnel·les de leur territoire d’action, et 13 avec des acteur·rices nationaux·ales. Les 50 entretiens avec les entrepreneur·ses m’ont quant à eux permis d’en rencontrer 33, dont 19 avec qui j’ai échangé plusieurs fois pour constater l’évolution de leur activité sur une période de 12 à 18 mois. Parmi ces 33 entrepreneur·ses, 12 sont accompagné·es par Osez entreprendre et 15 par la Miel. Sur ces 27 personnes suivies par les structures enquêtées, 18 sont des femmes. L’analyse de leurs expériences entrepreneuriales est privilégiée dans cet article. Aux entretiens formalisés s’ajoutent des discussions informelles lors d’événements. Ces dernières m’ont permis de discuter régulièrement avec 4 autres entrepreneur·ses accompagné·es par la Miel.
| La Miel | Osez Entreprendre | Échelle nationale | Total | |
| Membres de la structure | 9 (dont 1 deux fois) | 8 (dont 1 deux fois) | 17 | |
| Entrepreneur·ses | 15 (dont 8 deux fois) | 12 (dont 10 deux fois, et 1 trois fois) | 6 (dont 1 deux fois) | 33 (dont 21 femmes) |
| Acteur·rices institutionnel·les du territoire | 18 | 13 | 13 | 54 |
| Total | 42 | 33 | 19 | 104 |
Les entretiens sont structurés en trois temps : le profil de l’activité et de l’acteur·rice enquêtée, l’ancrage partenarial et territorial, les représentations de l’entrepreneuriat. Ils ont duré entre 20 minutes et 3 heures selon l’aisance de l’interlocuteur·rice et ont été enregistrés et retranscrits avec son accord. Ils sont analysés selon une grille thématique : la présentation générale de l’activité de la personne enquêtée, son mode d’accompagnement entrepreneurial, son ancrage territorial, ses partenaires, son modèle économique et son rapport à l’entrepreneuriat qui comprend ses motivations à entreprendre, sa définition de l’entrepreneuriat, les compétences qu’elle juge utiles, etc. J’ai mené des entretiens semi-directifs avec les acteur·rices institutionnel·les pour acquérir des informations factuelles et discursives sur le soutien à l’entrepreneuriat en QP. J’ai préféré mener des récits de vie (Bertaux, 1997) avec les entrepreneur·ses car cette forme les laisse libres d’aborder les thèmes qui leur sont chers et révèle le parcours biographique dans lequel s’ancre leur activité. Elle met au jour des enjeux de genre sans que la question ne soit explicitement abordée.
J’ai également observé 43 événements liés à la Miel ou à Osez entreprendre, en adoptant autant que possible une posture passive pour peu modifier leur déroulé. Ces structures organisaient l’événement, y participaient ou en faisaient sa publicité : des temps de sensibilisation et d’information comme des séances de tractage sur les marchés alimentaires, des formation collectives sur des thèmes comme la rédaction d’un bilan prévisionnel, des moments de mise en réseau comme des apéritifs dînatoires, des réunions techniques comme des comités de pilotage[12]. Parmi ces événements, certains sont consacrés aux entrepreneuses. L’observation permet d’appréhender qui sont les acteur·rices institutionnel·les soutenant l’entrepreneuriat en QP, qui sont les entrepreneur·ses qu’iels aident, quels contenus et formats d’accompagnement leur sont proposés, quels espaces iels s’approprient.
Enfin, j’ai analysé des documents produits par les acteur·rices rencontré·e·, que j’ai récupérés pendant des entretiens, des observation ou sur l’Internet. L’analyse de documents offre des données sur les actions d’aide à l’entrepreneuriat mis en œuvre en faveur des femmes et/ou des QP. Elle permet aussi de déterminer les termes que les auteur·rices associent à l’entrepreneuriat, aux femmes et/ou aux QP. Les documents analysés sont variés : décrets et conventions politiques sur les objectifs et l’application de l’accompagnement à la création et au développement d’activité en politique de la ville, rapports et bilans d’activité des acteur·rices de terrain, flyers et dossiers de presse promouvant des événements ou des dispositifs, etc.
Venons-en aux résultats issus de l’enquête qualitative, en abordant d’abord en quoi les pratiques entrepreneuriales et spatiales des femmes en QP sont structurées par leur genre. Ces pratiques reposent sur des actes de soin interpersonnels, qui constituent selon les contextes un facteur limitant ou/et une ressource pour entreprendre.
3. L’entrepreneuriat des femmes en QP, des pratiques spatiales de soins structurées par des inégalités de genre
3.1 La conciliation des fonctions de mère et de travailleuse restreint la mobilité des entrepreneuses
De façon générale, les femmes rencontrées entreprennent pour prendre soin de leur famille. En effet, le déclenchement de l’acte d’entreprendre dépend souvent de la naissance d’un enfant. Sur les 16 mères enquêtées, 6 ont spontanément déclaré être devenues entrepreneuses après une grossesse. Celle-ci conduit à repenser son rapport à la vie, au travail, et à gérer différemment le temps accordé à la famille. Par exemple, une entrepreneuse a commencé à imaginer son projet d’entreprise après la naissance de sa première fille. En élaborant des produits cosmétiques zéro déchet issus d’ingrédients provenant d’Afrique de l’Ouest, elle veut à la fois répondre aux besoins capillaires de ses filles noires et leur laisser un « monde meilleur » en proposant « un nouveau mode de consommation et de production » qui concrétiser « un sens à [l]a vie que je puisse transmettre à mes enfants ». L’entrepreneuse veut aussi gérer son temps de travail pour « avoir un peu plus de temps pour voir ses enfants » (septembre 2018). Si la hiérarchie impose des horaires dans le travail salarié, la création d’activité rend l’entrepreneuse libre de son emploi du temps : 13 des 16 mères enquêtées citent spontanément l’adaptation de leur sphère professionnelle à leur sphère familiale comme motivation à entreprendre.
Ainsi, elles concilient leurs tâches entrepreneuriales à leurs tâches domestiques pour s’occuper de leurs enfants[13]. Contraints par leur fonction familiale, leurs déplacements pour développer leur activité entrepreneuriale sont limités spatialement et temporellement. Parmi les 16 mères, 5 évoquent spontanément la restriction spatiale de leur entreprise car elles doivent rester proches de l’école de leurs enfants ; 4 expliquent que la garde des enfants empêche leur présence aux événements entrepreneuriaux organisés en soirée. Une traiteuse d’apéritifs sub-africains accompagnée par Osez entreprendre ne se rend pas à la Maison de la création et de la transmission d’entreprises (MCTE) où se déroulent régulièrement des rendez-vous avec sa conseillère et des événements entrepreneuriaux. La MCTE est située à proximité du centre-ville nantais que la traiteuse juge trop éloigné de son quartier, lieu de vie où elle s’occupe de ses enfants en bas âge. Comme elle s’occupe seule de sa fille de 4 ans, une autre entrepreneuse, architecte en conception lumineuse accompagnée par la Miel, ne participe pas aux soirées de mise en réseau. Les soins que ces mères entrepreneuses accordent à leurs enfants réduisent ainsi la mobilité spatiale et le temps de concentration dédiés à leur activité économique. L’emploi du temps chronométré de l’une de ces entrepreneuses est révélateur de cette situation partagée. Pendant deux ans, elle organise rigoureusement son temps quotidien entre sa vie professionnelle et sa vie familiale : elle amène sa fille aînée à l’école primaire à 8h, conduit la cadette âgée d’un an chez ses parents situés à 15 minutes en voiture, gère son temps libre pour développer son activité, retourne chez ses parents prendre le bébé avant de récupérer la première à l’école à 16h30, s’occupe d’elles jusqu’à leur coucher, pour passer ensuite une partie de sa nuit à développer son projet d’entreprise. Épuisée, elle reconnaît que sa maternité contraint sa posture d’entrepreneuse. La fonction de mère restreint ainsi l’accès aux ressources entrepreneuriales des femmes, qui agissent surtout à l’échelle locale. A l’inverse, les entrepreneurs enquêtés n’abordent pas le sujet des enfants en entretien.
3.2 Le sentiment d’illégitimité entrepreneuriale restreint le déploiement de l’activité des femmes
Les expériences entrepreneuriales des femmes enquêtées s’éloignent des normes androcentrées, ce qui renforce leur sentiment d’illégitimité à se dire entrepreneuse devant les autres. Une prestatrice de chorales d’entreprise est ébranlée par sa lente réussite économique par rapport à celle rapide de son frère : « Mais il n’est pas du tout dans la même démarche. Il fonce. Lui, il va […] c’est hyper déstabilisant. Mais tu te dis, c’est quoi mon problème ? » (mars 2019). L’architecte en conception lumineuse se fait violence quand elle démarche des client·es car elle : « flippe toujours par rapport à ce que je pourrais apporter, à ma valeur ajoutée. Je sais que oui, ça va, j’ai réussi des choses, j’ai des preuves que je peux faire des choses et tout, mais je ne suis jamais confiante. Jamais. J’ai toujours peur et ça évolue tellement rapidement à une vitesse exponentielle, que ça me fait flipper » (octobre 2018). Au manque de confiance en ses compétences professionnelles alors qu’elle est diplômée et possède une expérience du métier, s’ajoute un sentiment de mal parler français car elle est tunisienne. Cet exemple révèle l’enjeu de prendre en compte la dimension intersectionnelle des inégalités[14] en entrepreneuriat, d’autant plus prégnant en QP où les personnes de classes populaires et/ou d’origine étrangère sont nombreuses.
La dévalorisation d’elles-mêmes des entrepreneuses influence et restreint leurs pratiques économiques et spatiales : une grande partie n’ose pas aller dans des lieux de rencontres entrepreneuriales qu’elles jugent trop bien pour elles. Quand elles sont présentes à ces événements, elles éprouvent des difficultés à se rendre visibles et/ou déprécient les prix des produits qu’elles y vendent. Leur posture d’infériorité impacte la taille et le développement de leur activité. Les entrepreneuses enquêtées choisissent majoritairement le statut de la micro-entreprise alors que leurs homologues masculins privilégient la société par action simplifiée (SAS). Ce constat local rejoint des résultats nationaux. D’aprèsl’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, 55 % des travailleuses indépendantes sont des micro-entrepreneuses alors que la moyenne des micro-entrepreneur·ses chez l’ensemble des travailleur·ses indépendant·es se situe à 47 % en 2019.
3.3 Un genre féminin parfois source d’opportunités
Des entrepreneuses mettent néanmoins à profit leur ancrage local pour développer leur activité. Elles mobilisent les liens forts, c’est-à-dire leur réseau familial et amical[15], qu’elles possèdent dans leur quartier pour créer, tester, faire de la publicité et /ou vendre leurs produits. Cet ancrage local est d’autant plus marqué en QP où vit beaucoup de personnes de classes populaires. Ces dernières mobilisent des ressources locales à défaut d’avoir accès aux ressources économiques, culturelles et sociales des classes moyennes et supérieures (Collectif Rosa Bonheur, 2014). Après un troisième accouchement, une femme décide de se mettre à son compte pour concilier le travail, le soin de ses enfants et ses activités bénévoles. Elle transforme le rez-de-chaussée de sa maison en espace de coworking, qu’elle souhaite convivial pour parer la solitude des travailleur·ses indépendant·es : « j’ai fait un truc qui est resté une maison […] C’est très petit, on est une échelle vraiment très très petite. Et du coup, je vois que ça correspond à d’autres gens, qui me disent : “[quand] je suis dans un espace de coworking plateau, je n’aime pas ça, je me sens mal” » (mai 2019). Elle y héberge plusieurs entrepreneuses desquelles elle se sent proche car elles partagent les mêmes aspirations de reconversion professionnelle et vivent à côté. Leurs relations sont amicales plus que professionnelles : « ici, c’est vrai, on se soutient beaucoup en tant que femmes. On est entrepreneuses, on est des femmes, on a des enfants, on veut faire des projets, on y croit ». L’une des entrepreneuses hébergées est d’ailleurs l’amie de sa voisine avec qui elle jardine souvent. Ainsi, l’activité économique de la gérante de l’espace de coworking imbrique sa vie personnelle et professionnelle à l’échelle locale : elle repose sur des pratiques de soin accordées à ses voisines et à sa famille, elle entremêle son lieu de vie et son lieu de travail.
Cette imbrication comporte toutefois des limites. « Mécène de mes coworkeuses », l’entrepreneuse baisse ses tarifs pour réduire leurs charges mais nuit à sa propre rentabilité. Affirmant qu’« on n’a pas l’ambition de faire [de l’argent], à part d’en vivre, pour moi, voilà. L’ambition, ce n’est pas que ça génère de l’argent, de l’argent », elle travaille sans tirer de rémunération et compte sur le soutien financier de son époux. L’éthique du care qui sous-tend son activité la conduit à fournir un travail gratuit qui accentue sa précarité et sa dépendance financière. Consciente que cette situation n’est pas pérenne, elle se préoccupe beaucoup de trouver un équilibre financier alors que « je ne sais pas bien valoriser, je pense. Moi, je n’ai pas de dons commerciaux de malade, en fait, même très très peu ». Elle envisage de proposer des prestations de team building[16] à des entreprises en complément des bureaux loués. Celles-ci lui apporteraient un revenu en lui permettant de continuer à héberger ses homologues à prix coûtant.
Face aux inégalités de genre qui réduisent les déplacements et le développement économique des entrepreneuses, les associations de soutien à la création d’activité mettent en place des pratiques d’accompagnement adaptées à leurs besoins.
4. Des conseiller·es qui prennent soin des entrepreneuses en QP
4.1 Des moments dédiés aux entrepreneuses
La Miel et Osez Entreprendre ont intégré les prérogatives gouvernementales qui privilégient les femmes et financent les actions qui leur sont destinées. De fait, elles proposent de plus en plus d’offres dédiées aux entrepreneuses qui sont ciblées ou non sur les QP. Par exemple, la Miel relaie sur ses réseaux sociaux les événements, les appels à projets, les concours et les financements spécifiques à l’entrepreneuriat féminin. Elleorganise aussi des moments consacrés aux entrepreneuses, comme Osez entreprendre. Depuis 2017, les conseillers de ce dispositif proposent chaque année la journée « Créa au féminin ». Moins axées sur les dimensions économiques que sur les échanges d’expériences, les formations qui s’y déroulent relèvent plus de l’esprit d’entreprendre que des moyens de développer son activité. Dans une atmosphère conviviale, les conseiller·es animent des ateliers collectifs intitulés « se poser les bonnes questions », « trouver la bonne idée », « pitcher[17] son projet » et « se faire confiance pour entreprendre ». Une séance plénière est consacrée au partage de témoignages et à des discussions par groupe autour de « l’audace » et de « l’intuition ». Contrariées de n’avoir pu échangé autant qu’elles le souhaitaient pendant la première édition de « Créa au féminin », les participantes ont demandé aux conseiller·es d’étendre les horaires de l’événement qui se déroule désormais sur deux journées.

Figure 3 : Flyer de Créa au féminin, édition 2019 / source : Osez Entreprendre, 2019. Le visuel du flyer ponctué de bulles colorées et de mots-clefs traduit l’objectif d’Osez entreprendre de proposer un événement convivial porté sur les échanges et la confiance en soi. La figure de l’entrepreneur encravaté derrière son bureau a été remplacée par l’image d’une jeune femme à l’allure décontractée et joyeuse.
De son côté, la Miel lance sa première soirée dédiée aux entrepreneuses en 2018. Les participantes écoutent l’histoire de femmes dont l’activité est en plein développement et leur posent des questions. La discussion s’ouvre ensuite à l’ensemble de la salle. Les entrepreneuses abordent des thèmes généraux comme le financement, mais aussi des thèmes spécifiques à leur situation féminine : les enfants comme motivation et frein à leur activité, leur charge mentale vis-à-vis de la stabilité financière et affective de la famille, le rôle du mari, leur besoin de créer une activité bénéfique aux autres et/ou à l’environnement, etc. La soirée s’achève par un buffet qui favorise des discussions plus informelles et intimes.
4.2 Accroître la légitimité des entrepreneuses
A travers ces événements, les conseiller·es cherchent à augmenter les capacités d’action et la légitimité des femmes en renforçant leurs compétences et leur confiance en elles, alors que le contexte entrepreneurial institutionnel et territorial les discrimine. En travaillant en QP, iels accueillent des personnes souvent d’origine étrangère, plus précaires et moins diplômées qu’ailleurs, qui sont d’autant plus déligimées qu’elles s’éloignent de la figure archétypale de l’entrepreneur. En outre, leur accès aux ressources pour entreprendre est limité par leur inscription en QP où les services sont moindres. Dans ce cadre inégalitaire, les actions de conseiller·es sont parfois motivé·es par leur souci d’aider des personnes précarisées. Pour reprendre la distinction opérée par la sociologue féministe Beverley Skeggs (1997), leur care for découle d’un care about[18]. Un conseiller formé en école de commerce et par des stages en grandes entreprises, qui vient de Marseille et n’a jamais vécu en QP, a finalement décidé de rejoindre la Miel et la Seine-Saint-Denis pour aider ses habitant·es : « c’est de donner accès un petit peu à la réussite à tout le monde. Parce que c’est intéressant d’accompagner des start-ups sur Paris, mais ça l’est encore plus d’accompagner des start-ups ou même pas des start-ups, des TPE[19], à Plaine Commune. On se sent plus utile » (mai 2018)[20].
L’ensemble des conseiller·es rencontré·es met l’accent sur l’acquisition de compétences[21] qui favorisent l’autonomie d’action, en valorisant le processus d’indépendance davantage que l’indépendance en elle-même. Il s’agit de rendre capable de faire par soi-même. Selon une conseillère, l’accompagnement à l’entrepreneuriat atteint cet objectif car il consiste en : l’« accultur[ation] progressiv[e] à tout ce qu’il faut connaître pour être autonome dans son activité » (janvier 2018). Finalement, les conseiller·es proposent des formes de travail social. La Miel et Osez entreprendre évaluent d’ailleurs leurs actions en comptant le nombre de « sorties positives » qui dépassent la création effective d’entreprises : elles englobent aussi le retour à l’emploi salarié et le suivi d’uneformation professionnalisante.
Pour accroître l’autonomie des entrepreneuses, les conseiller·es leur apportent des connaissances techniques et des contacts à travers les formations qu’ils organisent. Iels ont aussi un rôle maïeutique visant à favoriser la réflexivité des entrepreneuses. Un conseiller de la Miel déclare : « Souvent, on essaye de les amener, enfin, de les questionner, pour voir ce qu’ils répondent, et on essaye de jouer un peu le rôle de miroir. Qu’ils se rendent compte d’eux-mêmes » (avril 2018). En outre, les conseiller·es valorisent les entrepreneuses en leur donnant un rôle à jouer dans le développement économique local par l’accès à des lieux de vente dans l’espace urbain. En partenariat avec les élu·es locaux·ales, la Miel aide ses entrepreneuses à obtenir des stands de vente à la Foire des savoir-faire solidaires, à la Fête des tulipes et au Festival des cultures urbaines, trois événements festifs annuels organisés par les collectivités locales qui se déroulent dans des espaces publics réputés de Saint-Denis[22]. Certaines entrepreneuses exposent aussi leurs produits dans des boutiques locales gérées par des acteur·rices public·ques et partagées entre plusieurs vendeur·ses. Le soutien de la Ville et de l’Intercommunalité en faveur des initiatives entrepreneuriales locales se révèle alors important.
Les conseiller·es à l’entrepreneuriat prennent soin des femmes pour augmenter leurs capacités d’action dans un contexte inégalitaire. Pour autant, leurs pratiques ne remettent pas en cause les inégalités structurelles de genre.
5. Des pratiques de care sans projet politique
5.1 Une conscientisation collective des inégalités de genre en entrepreneuriat
Les événements consacrés aux entrepreneuses constituent des moments où elles prennent conscience collectivement que les difficultés qu’elles rencontrent sont partagées, et non le fait de leur faiblesse individuelle, car elles reposent sur des inégalités structurelles de genre. La mise en commun de leurs problèmes leur permet de prendre du recul, de se conseiller et de partager leurs ressources d’adaptation. Selon la prestatrice de chorales d’entreprise, ces temps collectifs lui permettent « d’endosser une armure » (mars 2019) contre les obstacles sur lesquels elle bute au quotidien dans sa démarche entrepreneuriale.
Ces bulles de réconfort et de soutien psychologique sont parfois le lieu de critiques contre les inégalités de genre. Pendant une soirée d’entrepreneuses organisée par la Miel, une participante condamne la « charge mentale » (novembre 2018) qui pèse sur les femmes. L’une des deux intervenantes rappelle que « derrière la réussite d’un homme, il y a toujours une femme » et la seconde encourage l’auditoire à prendre confiance en soi car « vous avez toutes autour de vous des imbéciles [hommes] qui ont réussi ». Cette dimension contestataire et revendicatrice se retrouve dans des éléments de communication de la Miel.

Figure 4 : Invitation à une soirée d’entrepreneuses organisée par la Miel en mars 2021 / Source : La Miel, 2021.
Reprenant elle aussi l’emblème qu’est Beyoncé en imitant sa démarche devant l’auditoire de « Créa au féminin », une participante déclare haut et fort aux femmes présentes qu’il faut « oser et s’imposer ». Émerge un sentiment d’appartenance collective fondé sur l’expérience partagée d’obstacles genrés à entreprendre. L’affirmation en collectif de leur pouvoir se comprend par le souci de prendre soin de ses paires. Plusieurs entrepreneuses enquêtées mènent des activités d’entraide, en devenant notamment les mentores de porteuses de projet en difficulté. De receveuses du care des conseiller·es, elles en deviennent les donneuses auprès de leurs homologues.
5.2 Un monde entrepreneurial toujours androcentré
Malgré ces formes de conscientisation collective, les pratiques de soin des conseiller·es et des entrepreneuses se restreignent à des relations d’aide interindividuelles. Elles ne relèvent pas de la théorie politique du care formulée par Joan Tronto car elles ne fondent pas un projet collectif qui transforme les valeurs et les rapports de pouvoir dans la société. Les conseiller·es organisent des événements consacrés aux femmes sans prendre en compte et/ou modifier le contexte genré inégalitaire dans lequel elles se meuvent. Par exemple, la Miel propose des soirées aux entrepreneuses alors que beaucoup doivent garder leurs enfants leur soir. Les ateliers proposés pendant ces événements diffusent aussi les valeurs entrepreneuriales construites à partir d’un référentiel masculin : apprendre à pitcher pour avoir un discours performant, faire une étude de marché pour être concurrentiel, construire un business plan pour être rentable, etc. Les entrepreneuses intègrent ce référentiel. Lors de la même soirée organisée par la Miel, l’une des deux intervenantes a encouragé les participantes à « réfléchir comme un homme » (novembre 2018) pour développer leur entreprise. Finalement, l’aide apportée aux entrepreneuses repose-t-elle moins sur une stratégie réfléchie de lutte contre les inégalités de genre construite par les structures d’accompagnement que sur une opportunité de récupérer des fonds publics ciblés sur l’entrepreneuriat féminin en QP ?
Cet accompagnement à l’entrepreneuriat des femmes s’inscrit dans une approche émancipatrice libérale qui revendique l’égalité des droits dans la société de marché sans déstabiliser les rapports inégalitaires qui la structurent. Le soutien que les conseiller·es accordent aux entrepreneuses vise à les intégrer au monde économique conventionnel. Elles doivent apprendre à être disponibles et à se vendre comme les entrepreneurs pour réussir aussi bien qu’eux. En s’inspirant des travaux de la sociologue du travail Sophie Pochic (2018), cette forme d’accompagnement s’assimile à un « féminisme de marché » qui valorise individuellement les femmes mais néglige les causes structurelles des inégalités, qu’elle tend d’ailleurs à légitimer en reconnaissant le système économique en place. Le soutien à l’autonomie des entrepreneuses illustre ce constat. En renforçant leurs capacités d’action individuelles, les conseiller·es les inscrivent dans la rationalité néolibérale : les entrepreneuses doivent s’améliorer continuellement en maintenant une posture dynamique et en multipliant les projets pour être économiquement valorisables (Boltanski & Chiapello, 2011). In fine, elles deviennent seules responsables de leur parcours professionnel. Une conseillère d’Osez entreprendre déclare : « le fait de mettre des moyens à disposition pour les accompagner dans ce cadre-là les font aller dans une dynamique. Et peut-être de manière plus volontaire que si on les rentre dans une dynamique de recherche d’emploi. Parce que là, il y a vraiment aussi une autonomie. Finalement, les gens sont obligés aussi de se prendre en main, de bouger pour avancer, même s’ils sont accompagnés » (août 2018).
Dans ce cadre, la politique publique de soutien à l’entrepreneuriat des femmes en QP entrave plus qu’elle ne favorise le changement économique, social et politique. L’objectif d’égalité des chances à entreprendre représente d’ailleurs une « distraction » : sous couvert d’accorder aux femmes le droit à créer son activité et à travailler, il masque l’injonction qui leur est faite de continuer à effectuer la majorité des tâches domestiques (Calas & al., 2009, p.558). En conciliant leurs fonctions maternelle et professionnelle par la création de leur activité, les entrepreneuses reproduisent la division sexuelle des tâches et restreignent leur mobilité spatiale. L’entrepreneuriat leur permet de s’approprier leur aspiration à la maternité en jouant le jeu des inégalités structurelles de genre[23].
Conclusion
L’article met en lumière les limites du soutien à l’entrepreneuriat des femmes en QP comme politique de réduction des inégalités genrées et spatiales. L’accompagnement à la création d’activité améliore la situation individuelle d’entrepreneuses en QP en les intégrant au marché dont elles sont facilement exclues. Malgré les pratiques de soin accordées par les conseiller·es pour renforcer leur légitimité et leurs capacités d’action, les inégalités de genre structurent toujours l’entrepreneuriat et réduisent les pratiques spatiales des femmes. L’encouragement à l’entrepreneuriat féminin en QP que portent les pouvoirs publics s’inscrit dans une approche émancipatrice libérale.
De plus, ce soutien public à la création d’activité centré sur les entrepreneuses tend à faire oublier d’autres formes d’inégalités présentes dans les QP. D’une part, la territorialisation de l’accompagnement à l’entrepreneuriat en politique de la ville peut reproduire une violence symbolique par la stigmatisation spatiale. Conscient de cet écueil, les conseiller·es prennent soin de différencier le moins possible les entrepreneuses implantées en QP des entrepreneuses localisées ailleurs. D’autre part, qu’en est-il de l’aide à la création d’entreprise pour les publics racisés[24] ? Plusieurs chercheur·ses en sciences sociales démontrent que la figure d’une République française universaliste et égalitaire nuit à la reconnaissance de la race comme mode d’appréhension des inégalités sociales (Poiret, 2011 ; Amiraux & Simon, 2006). L’approche intersectionnelle s’avère alors pertinente pour comprendre les complexes imbrications des rapports de domination et la diversité des trajectoires dans l’entrepreneuriat en QP, territoires où les populations d’origine étrangère et/ou appartenant aux classes populaires sont nombreuses[25].
Finalement, l’article incite à redéfinir l’entrepreneuriat et l’action publique territoriale selon une perspective féministe. Il s’agit de légitimer les expériences qui s’écartent des valeurs entrepreneuriales andro et occidentalocentrées en les considérant comme des productrices utiles à la vie économique et sociale quotidienne. En articulant le concept de care à l’entrepreneuriat, l’article montre en creux l’importance de l’entraide, de l’ancrage local et des émotions dans la fabrique urbaine en atténuant l’importance généralement accordée à la croissance et à la rentabilité. Fidèle à Joan Tronto, il invite ainsi à replacer le care au centre de l’organisation sociétale en visibilisant son déjà-là dans les pratiques entrepreneuriales en quartier prioritaire. Il rappelle que les ces territoires sont le lieu de liens pluriels d’entraide économiques et sociaux avant d’être des « territoires fragiles ».
Par conséquent, les résultats de l’article encouragent à valoriser les pratiques d’entrepreneur·ses et de conseiller·es situés dans des territoires souvent discrédités en poursuivant des recherches qui montrent les effets des expériences entrepreneuriales de personnes minorées sur la cohésion socio-territoriale urbaine (Hersent & Soumbou, 2011). Il encourage aussi le financement public de ces pratiques micro-locales dont certaines relèvent du care, alors que l’arrivée en 2019 de la BPI comme responsable national du soutien à l’entrepreneuriat en politique de la ville laisse présager une réorientation des moyens au profit des entreprises à potentiel de développement qui visent la croissance. Cette inquiétude est partagée par les membres d’Osez entreprendre, qui s’opposent à l’« approche business » de la BPI et craignent de rentrer dans une logique de performance au détriment d’une logique de soutien qui demande de l’implication et du temps.
Références bibliographiques :
Amiraux V. & Simon P., 2006, « There are no Minorities Here: Cultures of Scholarship and Public Debate on Immigrants and Integration in France », International Journal of Comparative Sociology, p.191-215.
Boltanski L. & Chiapello E., 2011, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boring A., 2016, « L’entrepreneuriat des femmes : motivations et obstacles », Regards croisés sur l’économie, n°19, p.130-142.
Brun A., Gherardi S. & Poggio B., 2004, « Doing Gender, Doing Entrepreneurship : An Ethnographic Account of Intertwined Practices », Gender, Word and Organisation, 11, p.406-429.
Calas M., Smircich L. & Bourne K., 2009, « Extending the boundaries : reframing « entrepreneurship as social change » through feminist perspectives », Academy of Management Review, 34, p.552-569.
CGET, ONPV, 2019, Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires, Paris, CGET.
Chabaud D., Messeghem K. & Sammut S., 2010, « Vers de nouvelles formes d’accompagnement ? », Revue de l’Entrepreneuriat, 9, p.1-5.
Cho S., Crenshaw K. & McCall L., « Toward a Field of Intersectionality Studies : Theory, Applications, and Praxis », Signs, p.785-810.
Clément L., 2022, L’entrepreneuriat pour tous dans les quartiers. Mise en œuvre et effets socio-spatiaux de l’accompagnement à la création et au développement d’activité en politique de la ville. Plaine Commune et Nantes Métropole, Thèse d’aménagement-urbanisme, Université Paris Nanterre.
Collectif Rosa Bonheur, 2014, « Comment étudier les classes populaires aujourd’hui ? Une démarche d’ethnographie comparée », Espace et sociétés, p.125-141.
Conradson D., 2003, « Geographies of care: spaces, practices, experiences », Social and Cultural Geography, p.451-454.
Couteret P., 2010, « Peut-on aider les entrepreneurs contraints ? Une étude exploratoire », Revue de l’Entrepreneuriat, p.6-33.
D’Andria A. & Gabarret I., 2016, « Femmes et entrepreneurs : trente ans de recherches en motivation entrepreneuriale féminine », Revue de l’Entrepreneuriat, p.87-107.
De Sa Mello Da Costa A. & Silva Savaira L.A., 2012, « Hegemonic discourses on entrepreneurship as an ideological mechanism for the reproduction of capital », Organization, p.587-614.
Essers C. & Benschop Y., 2007, « Enterprising Identities : Female Entrepreneur of Moroccan or Turkish Origin in the Netherlands », Organization Studies, 28, p.49-69.
Fischer B., Tronto J., 1991, Towards a Feminist Theory of Care. In : ABEL E., NELSON M. (dir.) Circles of Care : Work and Identity in Women’s Lives. New York, University of New York Press.
Gauthier O., 2020, « Valeur(s), entrepreneuriat et diversité de l’entreprendre », Revue de l’Entrepreneuriat, p.117-132.
Gilligan C., 1982, In A Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Cambridge, Harvard University Press.
Glémain P., Bioteau E. (dir.), 2015, Entreprises solidaires, l’économie sociale et solidaire en question(s), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 286p.
Grégoire-Gauthier A., 2020, « Vers une contextualisation de l’entrepreneuriat : typologie de la division du travail familial et du rapport à l’entreprise des femmes immigrantes entrepreneures à Québec », Revue de l’Entrepreneuriat, 19, p.49-72.
Gupta V., Turban D., Wasti A., Sikdar A., 2009, « The Role fo Gender Stereotypes in Perceptions of Entrepreneurs and Intentions to Become an Entrepreneur », Entrepreneurship Theory and Practice, p.397-417.
Hercule C., 2002, L’ancrage des entreprises dans les quartiers de la politique de la ville : ressources, proximités et réseaux des entrepreneurs, Thèse d’aménagement-urbanisme, Université Paris 1.
Hersent M. & Soumbou P-R., 2011, « Initiatives de femmes en migration dans l’économie solidaire », in Guérin I., Hersent M., Fraisse L., Femmes, économie et développement, Toulouse, ERES, p.205-220.
Hirata H., 2021, Le care, théories et pratiques, Paris, La Dispute.
Knight M., 2016, « Race-ing, Classing and Gendering Racialized Women’s Participation in Entrepreneurship », Gender, Work & Organization, 23, p.310-327.
Landour J., 2019, Sociologie des Mompreneurs. Entreprendre pour concilier travail et famille ?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Lawson V., 2007, « Geographies of Care and Responsibility », Annals of the Association of American Geographers, 97, p.1-11.
Lebègue T., 2015, « L’accompagnement institutionnel des femmes entrepreneures, quel modèle d’accompagnement pour les femmes créatrices de très petites entreprises », Revue de l’Entrepreneuriat,14, p.109-130.
Lévy-Tadjine T., 2004, L’entrepreneuriat immigré et son accompagnement en France, Thèse en sciences de gestion et management, Université du Sud Toulon Var.
Lussault M., 2018, « Chapitre 12. Porter attention aux espaces de vie anthropocènes Vers une théorie du spatial care », in Beau R., Larrère C. (dir.), Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, p.99 -218.
Luxembourg C. & Noûs C., 2022, « L’éthique du care comme procédé méthodologique et analytique : expérimentations à propos des rapports de genre dans l’espace public à Gennevilliers (2014-2020) », in Collectif, Fragments de Géo, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincenne.
Marlow S. & Martinez D., 2018, « Annual review article : Is it time to rethink the gender agenda in entrepreneurship research ? » International Small Business Journal, p.3-22.
Milligan C. & Wiles J., 2010, « Landscapes of care », Progress in Human Geography, p.736-754.
Nadesan M. & Trethewey A., 2000, « Performing the enterprising subject: Gendered strategies for success (?) », Text and Performance Quarterly, p.223-250.
Narayan D., 2005, Measuring Empowerment, cross-disciplinary perspectives, Washington, Banque Mondiale.
Notais A. & Tixier J., 2018, « Entrepreneuriat et innovation au coeur d’un territoire : le cas des femmes entrepreneures sociales des quartiers », Innovations, 57, p.11-37.
Ogbor J., 2000, « Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse : ideology-critique of entrepreneurial studies », Journal of Management Studies, 37, p.605-635.
Pailot P., Poroli C., Lee-Gosselin H. & Chasserio S., 2015, « Contribution à une lecture catégorielle et interactionniste de la légitimité des femmes entrepreneures », Revue de l’entrepreneuriat, 14, p.31-57.
Perren L. & Jennings P.L., 2005, « Government discourses on entrepreneurship: Issues of legitimization, subjugation, and power »,Entrepreneurship: Theory and Practice, p.173-184
Pochic S., 2018, « Féminisme de marché et égalité élitiste ? », in MARUANI M. (dir), Je travaille donc je suis. Perspectives féministes, Paris, La Découverte, p.42-52.
Poiret C., 2011, « Le processus d’ethnicisation et de raci(ali)sation dans la France contemporaine : Africains, Ultramarins et « Noirs » », Revue européenne des migrations internationales, p.110-124.
Santoni J., 2018, « Quels processus pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneures ? », Entreprendre et Innover, 36, p.29-40.
Skeggs B., 1997, Formations of Class & Gender. Becoming respectable, Londres, Sage Publications.
Tollis C., 2013, « Les spatialités du care. Une autre géographie des espaces naturels dits “protégés” », Éthique, politique, religions, p.103-120.
Tremblay M., Brière S. & Poroli C., 2020, Déconstruire les mythes pour mieux accompagner une diversité d’entrepreneures, Québec, Presses de l’Université Laval.
Tronto J., 2013, Caring Democracy. Markets, Equality and Justice, New York, New York University Press.
Tronto J., 2009, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte.
Van De Walle I., Aldeghi I., 2015, L’entrepreneuriat féminin dans les quartiers populaires, Paris, Crédoc.
Verzat C. & Gaujart C., 2009, « Expert, conseiller, mentor, confident ou tout à la fois ? », Expansion Entrepreneuriat,p.6-12.
[1] J’emploie la terminaison féminine en « -euse » pour visibiliser les femmes dans des secteurs où elles sont minorées.
[2] La Banque Mondiale participe notamment à diffuser ces préceptes en renforçant les dispositifs d’entrepreneuriat et de microcrédit féminins dans les pays dits en développement (Narayan, 2004).
[3] Par exemple, le document « Agir pour l’emploi et la création d’activités » entre l’État et la Caisse des Dépôts (2014-2017) publié en 2014 par le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la Caisse des dépôts et consignations, ou la circulaire interministérielle n°CAB2015/94 du 25 mars 2015 « relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de l’activité économique et de l’emploi » établie par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports.
[4] J’entends par là l’ensemble des éléments (financement, mise en réseau professionnelle, moyens logistiques, formations à l’entrepreneuriat, etc) qui permettent la création et le développement d’une activité économique.
[5] Terme utilisé par l’action publique pour désigner les quartiers prioritaires et les territoires ruraux en déclin.
[6] Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
[7] Ce numéro est dirigé par Yannick L’Horty et Pierre Morin.
[8] Par exemple, parmi les huit articles publiés dans le numéro susmentionné, quatre traitent des relations entre l’accès à l’emploi, la mobilité, et le lieu de résidence ; trois autres traitent des effets de la politique de zonage en termes de croissance économique et de discrimination. Aucun n’est consacré à l’entrepreneuriat.
[9] Les ZUS sont l’acronynme qui désigne les territoires de la politique de la ville avant sa réforme en 2014.
[10] De janvier 2018 à septembre 2019.
[11] Les données sont issues des rapports d’activité annuels des structures.
[12] Je n’ai malheureusement participé qu’à un seul entretien entre une entrepreneuse et une conseillère car ma présence pouvait gêner leurs interactions.
[13] Les mères entrepreneuses constituent un nouvel objet de recherche en sociologie du travail. Ces « Mompreneurs » sont le sujet d’une thèse récente (Landour, 2019).
[14] On assimile généralement la notion d’intersectionnalité à la juriste féministe Kimberlé Crenshaw qui a utilisé ce terme en 1989 pour mettre en lumière l’invisibilité juridique des discriminations liant le genre et la race auxquelles sont confrontées les femmes noires aux États-Unis (Cho et al., 2003).
[15] Dans les années 1970, le sociologue Mark Granovetter met en lumière deux types de relations sociales permettant de mobiliser des ressources : les « liens forts » sont les liens familiaux et amicaux intenses qui forment un réseau social homogène tandis que les « liens faibles » sont des relations de faible intensité susceptibles de former des « ponts » vers des cercles sociaux diversifiés.
[16] Cette expression anglophone désigne des activités qui visent à renforcer l’esprit d’équipe.
[17] Le pitch consiste à présenter son activité de manière rapide et éloquente à un auditoire pour le convaincre de sa pertinence.
[18] Le « care for » renvoie aux pratiques concrètes du care tandis que le « care about » renvoie à des dispositions personnelles et relationnelles.
[19] Cet acronyme signifie « très petites entreprises ».
[20] Malgré sa motivation d’aider des personnes moins dotées en ressources, le conseiller a finalement quitté la Miel faute de projets économiques jugés intéressants à accompagner.
[21] Cette notion, très étudiée en sciences de gestion, se définit comme « la capacité qu’a un individu à combiner différentes ressources afin de mener à bien ses actions dans les situations rencontrées » (Glémain et Bioteau, 2015, p.84).
[22] La Foire des savoir-faire solidaires se tient sur le parvis de la Basilique-cathédrale de Saint-Denis, classée monument historique national. La Fête des tulipes et le Festival des cultures urbaines prennent place dans le parc et la salle de la Légion d’honneur, ouverts au public exprès pour l’occasion.
[23] Dans la même veine, Majia Nadesan et Angela Trethewey mettent en valeur les contradictions présentes dans l’expérience d’émancipation d’entrepreneuses états-uniennes (2000). En s’appuyant sur une vingtaine d’entretiens, les chercheuses montrent que les entrepreneuses sont conscientes que leur genre influencent et limitent leur activité. Pour autant, elles s’adaptent aux normes genrées inégalitaires qui structurent l’entrepreneuriat sans les contester.
[24] La racisation désigne le processus par lequel une personne est assignée à une catégorie raciale. Cette catégorisation sert de support à des traitements inégalitaires et à des discriminations.
[25] Quelques travaux récents de sciences de gestion utilisent l’approche intersectionnelle. Annie Grégoire-Gauthier étudie par exemple le parcours de 25 femmes immigrées au Québec pour comprendre en quoi une origine géographique et un genre minorés induisent certaines pratiques entrepreneuriales (2020). La chercheuse Mélanie Knight appréhende quant à elle l’articulation des rapports de race, de classe et de genre dans la démarche entrepreneuriale d’une cinquantaine de femmes noires afro-caribéennes vivant aux Etats-Unis (2016). Enfin, Caroline Essers et Yvonne Benschop analysent les récits de vie de vingt entrepreneuses turques et marocaines habitant aux Pays-Bas pour comprendre comment elles s’approprient leur identité plurielle dans leur démarche entrepreneuriale (2007).