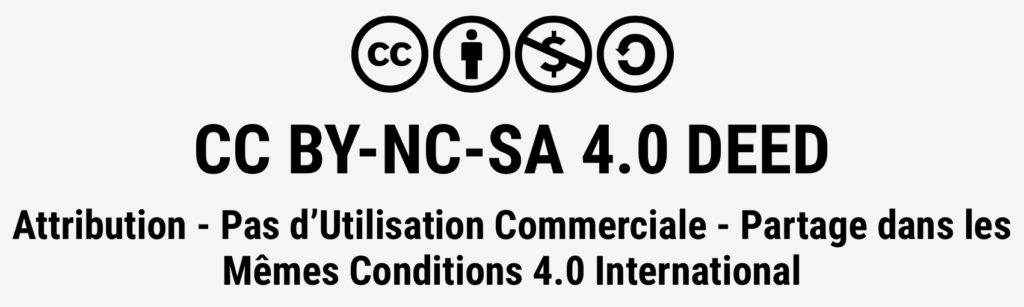New arrangements between mobility, distance and proximity: the need to go beyond dominant representations.
Luc Gwiazdzinski
〉Professeur de géographie, HDR
〉LRA, ENSA de Toulouse
〉luc.gwiazdzinski@toulouse.archi.fr
Vincent Kaufmann
〉Professeur de sociologie urbaine
〉Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
〉Directeur du LaSUR
〉vincent.kaufmann@epfl.ch
〉Article court 〉
Télécharger l'article. 4-2024 Gwiazdzinski & Kaufmann
Mots-clés : mobilité, rythmes de vie, représentation sociale, proximité, urbanisme
Abstract: Based on the sociological definition of mobility as a “transformation of the self”, this article questions the relevance of some of our collective representations of proximity and distance, and the consequences of the shifts they are likely to cause for the architectural and urban fabric. In the social sciences, and more particularly in human geography, it is common to consider that the amount of geographical space one crosses constitutes a kind of function of the change in position, role or state associated with it. The further we go, the more exotic or striking in terms of otherness, and therefore the more mobile we are. Conversely, the less we travel, the more reassuring it is, and the less mobile we are. However, these tenacious representations no longer correspond to the reality of the spatialization of contemporary societies and their relations of distance, overturned by the potential for speed and long-distance communication provided by technology, and the dependencies they entail.
Keywords: mobility, rhythms of life, social representation, proximity, urbanism
« Il faudrait que l’homme accroisse sa curiosité et accepte la complexité du monde dans lequel il vit ». Theodore Zeldin[1]
« L’aventure est-t-elle au coin de la rue ? ». Jacques Dutronc[2]
Préambule
Dans cet article, nous proposons de revisiter la définition sociologique de la mobilité comme une « transformation de soi » pour en explorer l’actualité dans un monde où en dépit de représentations sociales fortes, la quantité de distance géographique que l’on franchit n’a souvent plus grand-chose à voir avec l’altérité rencontrée, comme le souligne John Urry dans son ouvrage « Sociology beyond Societies, mobilities for the twenty first century » (Urry, 2000). A travers cette mise à l’épreuve d’un terme aussi utilisé, nous souhaitons questionner ici la pertinence de certaines de nos représentations collectives relatives à la proximité et à la distance et les conséquences des décalages qu’elles sont susceptibles d’occasionner sur la fabrique architecturale et urbaine.
1 . Une proposition : la distance parcourue n’est pas un bon indicateur de la mobilité
En sciences sociales, et plus particulièrement en géographie humaine, il est commun de considérer que la quantité d’espace géographique que l’on franchit constitue une sorte de fonction du changement de position, de rôle ou d’état qui y est associé (Frémont, 1976 ; Volvey, 2005). Dans cette optique, une mobilité de la vie quotidienne s’inscrit dans la proximité et se caractérise par une routine – « Cadre bien établi, où s’enchaînent de manière ordonnée des actions répétées chaque jour »[3] – bien analysée en sociologie (Meissonnier, Richer, 2015). Le voyage en revanche implique par définition de parcourir de grandes distances et est associé à l’idée de dépaysement – « Changement de pays, de lieu »[4]. La migration quant à elle est également associée au franchissement collectif d’une distance importante et à un changement de situation et de contexte. On pourrait multiplier les exemples. En clair, plus on va loin, plus c’est dépaysant ou marquant en termes d’altérité, et donc plus on est mobiles[5]. A l’inverse les représentations de la proximité renvoient à des notions de familiarité – «Haut degré de simplicité, d’intimité, dans les relations sociales ou dans les rapports particuliers qui unissent des personnes non apparentées »[6] -, d’attachement, de permanence : moins on se déplace plus c’est rassurant et moins on est mobiles. Ces représentations très tenaces ne correspondent cependant plus à la réalité de la spatialisation des sociétés contemporaines et de leurs rapports de distance bouleversés par les potentiels de vitesses et de communication à distance procurés par la technologie et les dépendances qu’ils entrainent (Gallez, 2019).
L’assertion consistant à considérer la mobilité et l’immobilité comme une affaire de volume de kilomètres parcourus, qui est souvent utilisée dans la recherche comme une évidence, a été définitivement bousculée par la collision des échelles et n’a aujourd’hui plus court (Offner & Pumain, 1996 Hannam et al., 2006). De plus, l’argument concerne les proximités et distances spatiales et sociales mais n’intègre pas d’autres formes de proximité que nous proposons de qualifier de « proximités affectives » au sens de « Mouvement de la sensibilité qui s’accompagne de plaisir ou de douleur. »[7]« L’intérêt et la difficulté de l’affect est que c’est une disposition affective élémentaire (p. oppos. à intellect), que l’on peut décrire par l’observation du comportement, mais que l’on ne peut analyser »[8]. Dans des sociétés d’archipels comme les nôtres, au sens de Jean Viard (Viard, 1998), les proximités affectives peuvent exister malgré ou avec les distances et discontinuités. Les télécommunications et l’immédiateté qu’elles permettent ont amplifié ce phénomène, notamment par l’intermédiaire de la démocratisation et de la généralisation des objets connectés et entraîné un changement de nos rapports à l’ici et l’ailleurs. Nous ne sommes pas là en opposition avec des auteurs (Beaude, 2012) qui nous invitent à considérer Internet non pas sous l’angle d’une technologie a-spatiale abolissant les distances et l’espace géographique mais au contraire comme un espace d’un genre nouveau et qui proposent une image plus complexe encore de nos espace-temps qui doit échapper aux caricatures
Toutes ces transformations, ces hybridations (Gwiazdzinski, 2016) et agencements complexes militent en faveur d’un dépassement des représentations collectives dominantes de la mobilité, qui restent très « spatialisantes » et associées à la quantité de distance et la vitesse à laquelle celles-ci sont parcourues (Gallez & Kaufmann 2009). Il est temps de les renouveler, car sans cela le risque est de passer à côté des transformations profondes et rapides des rapports à l’espace et au temps, dans le domaine des politiques urbaines en particulier.
2 . La multiplicité des agencements entre distance, proximité et mobilité
Pour travailler sur la question de la mobilité et des proximités, comme souvent en sciences sociales, la relecture d’auteurs pionniers permet de s’extraire des chemins de dépendances conceptuels dans lesquels la recherche se trouve parfois prisonnière (Gallez & Kaufmann 2009). Il en est ainsi de la mobilité telle que définie par Pitirim Sorokin (Sorokin, 1927). Cet auteur pionnier des travaux sur la mobilité sociale définit la mobilité comme un « changement de position », sans forcément faire référence à l’espace géographique d’ailleurs. Son objet de recherche est la transmission du statut socio-professionnel entre les générations. On lui doit notamment les tables de mobilité père/fils et les parcours professionnels qu’il analyse en termes d’échelles sociales. La définition de la mobilité qu’il propose comme « changement de position » présente une grande actualité, en particulier car elle ne fait aucun lien entre l’étendue du changement et l’espace, ce qui permet de s’affranchir de la représentation dominante que nous venons de discuter. Ce faisant, elle permet de concevoir la mobilité comme une « transformation de soi » sans attribuer à cette transformation une quelconque quantité de franchissement de l’espace géographique.
Or ce qui caractérise nos sociétés contemporaines est précisément cela : il n’y a plus de lien systématique entre la transformation de soi, les formes de proximités et les distances géographiques que l’on parcourt.
L’examen de quelques situations contemporaines permet de montrer ce qui pourrait apparaitre comme autant de paradoxes (Barrel, 1979 ; Kaufmann, 2008) mais constitue la banalité de nos quotidiens ou du voyage hypermoderne (Jaureguiberry & Lachance, 2016).
La première, correspond à la représentation sociale dominante que nous venons de décrire. Elle associe grande distance parcourue, grande interaction avec le milieu et grande transformation. On pense par exemple au voyage lointain dans un ailleurs où il faut s’adapter, apprendre la langue, entrer en contact, ou en d’autres termes être doué de motilité (Kaufmann, 2008). Chaque minute est une découverte, chaque rencontre ou presque un « surgissement » (au sens d’Henri Maldiney, 2012). Tout parait augmenté.
La deuxième renvoie à ce que Manuel Castells a décrit comme l’espace des flux (Castells, 1998). Dans cette situation les grandes distances parcourues s’accompagnent d’une faible interaction avec le milieu et une faible transformation de soi. L’individu reste alors prisonnier de l’espace des flux même si parfois quelque chose d’autre, une romance par exemple, peut en surgir comme dans « Lost in translation » de Sofia Coppola (2004). Comme exemples de cette situation, on peut retenir le voyage lointain dans des hôtels aseptisés partout les mêmes (Ostian, 2023) ; de même, les endroits traversés des aéroports internationaux et la carte des restaurants identiques à travers le monde (Montulet, 1998 ; Fumey, 2007), donc quelle que soit la distance parcourue.
Le troisième cas de figure renvoie à l’expérience urbaine ordinaire d’un monde contemporain marqué par la diversité. Le monde est dans nos villes. « Ce n’est pas la peine d’aller à Calcutta, à Melbourne ou à Vancouver, tout est dans les Yvelines, à Neauphle. Tout est partout. Tout est à Trouville. […] L’Asie à s’y méprendre, je sais où elle est à Paris…», écrivait déjà Marguerite Duras (Daney, 1980). En parcourant des petites distances dans les métropoles contemporaines, nous nous transformons beaucoup grâce à la rencontre et à l’expérience. Par exemple, on peut vivre une expérience mystique dans une église du quartier ou être transporté par l’écoute d’un musicien au coin de la rue. On peut tomber amoureux de son voisin de palier originaire du bout du monde et plus généralement trouver de l’exotisme dans la proximité.
Le dernier cas renvoie à l’immobilité et aux faibles interactions et expériences de proximité associées à la communication à distance. Dans cette situation, la transformation de soi est impossible car il n’y a pas d’attention à la proximité physique et pas non plus à l’altérité procurée potentiellement par le numérique. C’est un cas typique des relations amoureuses contemporaines : lorsqu’on est amoureux, on ne se quitte désormais plus jamais car on passe son temps à s’envoyer des messages et des photos dès que l’on n’est plus en proximité physique. Conséquence : lorsqu’ils se retrouvent en coprésence, les amoureux n’ont parfois plus grand-chose à se raconter. Ils se sont tout dit et écrit en photos et en textos quasiment en direct en communiquant à distance. Au risque d’un « épuisement accéléré de la relation » comme d’autres parlaient autrefois « d’épuisement des lieux » (Perec, 1982).
3 . Quelques pistes thématiques
Les quelques constats que nous venons de présenter le montrent : les représentations dominantes de la distance et de la proximité demandent à être ré-examinées, ainsi que celles de la mobilité, en s’adossant à la définition inspirée de Pitirim Sorokin : « La mobilité est une transformation de soi ». Plus précisément, sept observations ressortent de la discussion qui précède.
Le premier point est que la proximité est une dimension spatiale, mais également sociale et affective. Elle ne se réduit donc pas à la coprésence dans l’espace mais implique la coprésence spatiale du corps et de l’esprit avec des gradients d’intensité variables. De ce fait, elle pose les questions du sens, mais aussi de l’intentionnalité des individus, soit autant d’éléments qui ne relèvent pas des métriques, mais de l’accueil à la transformation. Nous pouvons alors examiner plusieurs postures :
- Certains cherchent la transformation à proximité sans bouger. Vivre c’est se confronter à l’altérité, s’en nourrir, alors pourquoi ne pas rester sédentaire ?
- Certains font tout en déplacement pour ritualiser et éviter la transformation. Pourquoi changer ? Un tien vaut mieux que deux tu l’auras.
- D’autres enfin sont à la recherche d’équilibres. Quelle balance entre sécurité et curiosité ?
Le deuxième aspect est la transformation de soi elle-même. Seul l’acteur est en capacité de juger et de mesurer sa mobilité en termes de transformation de soi, ainsi que de le verbaliser ou de le laisser paraître. Cela interroge l’ouverture et de la capacité de l’individu à se laisser transformer par les rencontres.
Le troisième aspect est l’impact de l’environnement construit, du milieu sur cette possible transformation. Les exemples qui précèdent posent en effet la question de la qualité de l’environnement, de la facilité de la transformation, avec des prises, des affordances et « potentialités » (Gibson, 1977 ; Norman, 1990) procurées par les espaces publics et plus généralement par les agencements spatio-temporels complexes des villes et des territoires. Les univers lisses laissent peu de place aux surgissements. Les quartiers de gare sont souvent parmi les plus favorables. L’approche laisse une place à l’architecte et à l’urbaniste pour la construction de l’hospitalité ou au contraire pour la tentative d’asepsie de la « prévention situationnelle » et de sa déclinaison en « urbanisme sécuritaire » qui facilite la mobilité physique et empêche la rencontre avec l’autre et le milieu, donc la transformation.
Le quatrième point renvoie à la question de la disponibilité de l’individu, sa posture, sa capacité à accueillir la transformation, et mieux, sa capacité à « ex-ister, se tenir hors de soi, en avant de soi » (Maldiney, 2003 ), sa capacité à la « présence » qui dit la même chose. Il faut « y être » pour que « ça ait lieu ».
Le cinquième aspect est la capacité de l’autre à faire surgir, à provoquer la rencontre, la transformation. La sérendipité, telle que décrite par Jacques Lévy (Lévy, 2011) comme une caractéristique propre à la ville correspond à ce surgissement, ce caractère fortuit des sociabilités. C’est la piste d’un art de la mobilité, de la transformation et de la rencontre qui est permis par les caractéristiques spatiales et temporelles d’un environnement construit. Un art des possibles.
Le sixième aspect renvoie à l’équilibre entre les deux pôles généraux de motivation de l’individu : la sécurité, source de confort mental et la variété, source de curiosité et de richesse perceptive, mais génératrice d’une éventuelle et relative insécurité (Cousin, 1980). Cette approche rejoint la « théorie des trajets sûrs » d’A. Moles et E Rohmer (1972) qui offrent au piéton, quels que soient le quartier et l’heure du jour et de la nuit, la possibilité d’établir sa trajectoire en fonction d’axes présentant un certain niveau de sécurité.
Enfin, septième aspect, les agencements complexes que nous avons décrits poussent à explorer la question des degrés de dialogue et d’agencements entre l’intentionnalité de la transformation chez l’individu, et les qualités de transformation et la réciprocité ou non des autres individus croisés. En miroir elle oblige à s’interroger sur la place du hasard, de la « sérendipité » et de l’improvisation (Soubeyran, 2015) dans nos milieux urbains. « On reconnait une ville à la place qu’elle laisse à l’improvisation » (Kracauer, 2013).
Deux points complètent cette exploration et constituent deux exigences.
Le premier est la nécessité d’une prise en compte de la collision des échelles (Offner & Pumain 1996) : l’intégration des expériences, de ces possibles transformations individuelles dans le cadre plus large et collectif d’un groupe voire d’une « foule » (Tarde, 1901) dans la « ville événement » (Boullier, 2010) avec des comportements qui ne sont plus les mêmes invitent à travailler simultanément les différentes échelles.
Le second demande un dépassement de l’approche anthropocentrée. Il concerne la possible transformation dans la rencontre de l’individu avec les acteurs « non-humain » (animaux, végétaux, objets matériels) auxquels les théoriciens de « l’acteur-réseau » (Alkirch, Callon & Latour, 2006) reconnaissent une capacité d’agentivité, d’interaction et un rôle dans la construction de la réalité sociale.
L’ensemble de ces constats invitent à réfléchir en termes de « mobilité/transformation potentielle » et de « mobilité/transformation effective » mais aussi en termes de passivité ou d’activité des protagonistes. Ils nous obligent à raisonner en termes de méthodologie des proximités et de mesure ou plutôt d’appréciation des mobilités/transformations. Outre les distances géographiques mesurables ou perçues, comment apprécier, mesurer les « transformations potentielles » (densités d’individus et d’interactions, diversité de l’environnement, étrangeté du milieu, curiosité ou au contraire sécurité…) et « les transformations effectives » de l’individu confronté à une mobilité transformatrice ? (progression de son intelligence territoriale ? De sa capacité d’adaptation …). Quels degrés de mobilité/transformation de l’individu peut-on imaginer ? Quel sens donner à la progression ? La réponse qui consisterait à vouloir classer au sommet de la grille d’évaluation le maximum de mobilité/transformation est-elle politiquement correcte et durable ?
Ces réflexions permettent de réfléchir au sens des « proximités affectives » au sens de l’affection comme « mouvement de la sensibilité qui s’accompagne de plaisir ou de douleur »[9]. Nous sommes là au croisement fécond de la géographie, de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques et de la proxémie (Hall, 1966). Nous proposons d’appeler « proxèmes » ces nouveaux agencements que nous projetons d’étudier dans leurs différentes dimensions (mesure, expérience vécue, perception, représentations…).
4. Ouverture
De ces quelques réflexions théoriques sur le renouvellement des agencements entre mobilité, distance et proximité émergent la remise en question de deux représentations collectives très largement partagées et : la valorisation des déplacements rapides, lointains et fréquents comme expression ultime de la liberté, d’une mobilité fluide et complète ; la valorisation de la place piétonne comme expression ultime d’une proximité heureuse dans laquelle les habitants de tout un quartier peuvent se retrouver, au-delà de leurs différences.
Il est temps de dépasser ces représentations collectives qui sont très présentes dans la recherche, dominent encore le débat politique en constituant le socle à partir duquel sont évalués de nombreux projets, quand la proximité est l’« argument » (Lebrun, 2023). Combien d’aménagements de places a-t-on justifié par la création « d’un espace public où tout le monde se retrouvera ». Combien de grands projets routiers a-t-on justifiés par le « désenclavement » ou en d’autres termes par l’introduction de la possibilité de se déplacer vite « pour être plus mobile » ?
Ces représentations collectives de la mobilité deviennent contre-productives tant elles sont en porte-à-faux avec les transformations rapides des proximités (Gall et al., 2024) et leurs paradoxes ainsi que la fabrication contemporaine des spatialités. Si l’aventure est au coin de la rue, l’aventurier est d’abord « celui qui fait arriver des aventures plutôt que celui à qui des aventures arrivent » (Debord, 1967).
Références bibliographiques :
Carini-Belloni B., 2021. « Un air de famille : médecins prolétaires et patients ouvriers dans les centres de santé mutualistes des Bouches-du-Rhône (1950–1989) », Histoire sociale, 2021, vol. 54, no 112, p. 627‑650.
Akrich M., Callon M. & Latour M., 2006, Sociologie de la traduction : textes fondateurs, Paris, Mines Paris-Tech, Les Presses.
Barrel Y., 1979. Le paradoxe et le système, Grenoble, PUG.
Beaude B., 2012, Internet. Changer l’espace, changer la société, Limoges, FYP.
Boullier D., 2010, La ville événement, Paris, PUF.
Castells M. 1998, La société en réseaux, Fayard, Paris
Cousin J., 1980, L’Espace vivant : Introduction à l’espace architectural premier, Paris, Le Moniteur.
Daney S. et al., 1980, « Marguerite Duras et le cinéma », Numéro spécial « les yeux verts », Les cahiers du cinéma, juin 1980
Debord G., 1967, La Société du spectacle, Paris, Gallimard.
Frémont A., 1976, La région espace vécu, Paris, PUF.
Fumey G., 2007, « La mondialisation de l’alimentation », L’information géographique, 2007/2, vol.71, pp.71-82
Gall C. & Gwiazdzinski L., Kaufmann V. & Torre A., 2024, Les Nouvelles proximités, Limoges, FYP
Gallez, C.. 2019. Dépendance à la mobilité et politiques urbaines. Réflexion sur les enjeux sociaux de la mobilité face à l’urgence climatique
Gallez, C. & Kaufmann V., 2009. Aux Racines de La Mobilité En Sciences Sociales.” in De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité?, V. Guigueno & M. Flonneau (dir.), Presses Universitaires de Rennes, pp. 41-45
Gibson J.J., 1977, « The Theory of affordances. » in Percepting, Acting and Knowing, Eds Robert Shaw and John Bransford.
Gwiazdzinski L., 2016, L’hybridation des mondes, Grenoble, Elya.
Hall E. T., 1966, The Hidden Dimension, Doubleday & Company.
Hannam, K., Sheller, M. & Urry J. 2006. “Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings.” Mobilities 1(1):1–22. doi: 10.1080/17450100500489189
Jaureguiberry F. & Lachance J., 2016, Le voyageur hypermoderne, Paris, Erès
Kaufmann V., 2005, « Mobilités et réversibilités : vers des sociétés plus fluides ? », Cahiers internationaux de sociologie Vol. CXVIII, pp. 119-136.
Kaufmann V., 2008. Les paradoxes de la mobilité. Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, coll. « Le savoir Suisse »
Kracauer S., 2013. Rues de Berlin (et d’ailleurs), Paris, Belles Lettres
Lebrun N., « Pour une conscience de proximité(s) », GéoProximitéS, 0 | 2023 – Ma proximité
Lévy, J. 2011, « La sérendipité comme interaction environnementale » dans D. Bourcier & P. van Appel (dir.) La sérendipité : le hasard heureux, Paris, Hermann, p. 279-285.
Maldiney H., 2003, Art et existence, Paris, Klincksiek.
Maldiney H., 2012, L’art, l’éclair de l’être, Paris, Cerf.
Meissonnier J. & Richer C., “Métro – boulot – dodo : quoi de neuf dans nos routines de mobilité ?” Espace Populations Sociétés, 2015, 1-2.
Moles A. & Rohmer E., 1972, Psychologie de l’espace, Paris, Casterman.
Montulet B., 1998, Les enjeux spatio-temporels du social. Mobilité. Paris. L’Harmattan.
Norman A., The design of Everyday Things Donald, Doubleday Business.
Offner J.-M. & Pumain D., 1996, Réseaux et territoires : significations croisées. La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube.
Ostian G., 2023, « D’Abidjan à Rabat en provenance de Paris. Sentiment de proximité dans les mobilités métropolitaines et concept de géoproximité » GéoProximitéS, 0 | 2023 – Ma proximité, ⟨hal-04303249⟩.
Perec G., 1982, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Paris, Christian Bourgeois.
Sorokin P., 1927, Social Mobility, New York, Harper & Brothers.
Soubeyran, O., 2015. Pensée aménagiste et improvisation. L’improvisation en Jazz et l’écologisation de la pensée aménagiste, Paris, Editions des archives contemporaines
Urry, J. 2000. Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century. London ; New York: Routledge.
Volvey A., 2005, Echelles et temporalités, Paris, Atlande.
Viard J., 1998, La société d’archipel, La Tour d’Aigues, L’Aube.
[1] In « L’hybridation des mondes », Gwiazdzinski L. (dir.), Elya, 2016
[2] Extrait de la chanson « On nous cache tout, on nous dit rien », paroles Dutronc J. et Lanzmann J., Album Et moi et moi et moi, Vogue, 1966
[3] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/routine
[4] https://www.cnrtl.fr/definition/dépaysement
[5] Pour une critique systématique de ces usages des notions de mobilité et de proximité, nous invitons le lecteur à consulter l’article de Kaufmann (2005).
[6] https://www.cnrtl.fr/lexicographie/familiarité
[7] https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/affection
[8] https://www.cnrtl.fr/definition/affect
[9] https://www.cnrtl.fr/
Pour citer cet article :
GWIAZDZINSKI Luc & KAUFMANN Vincent, « Nouveaux agencements entre mobilité, distance et proximité : de la nécessité de dépasser les représentations dominantes », 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-ac5/