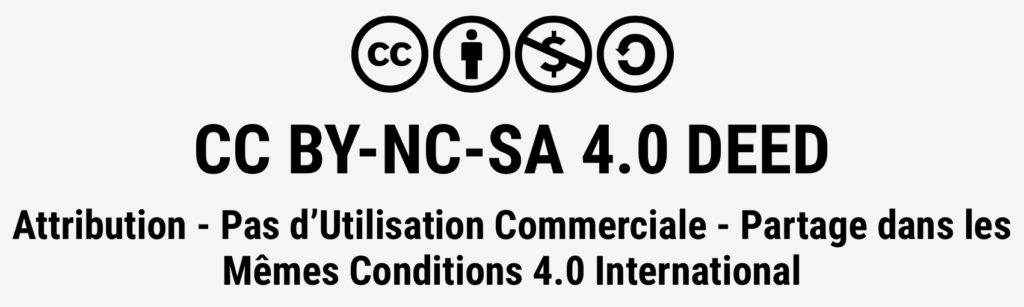Care for older people and migrant workers: distance(s) and proximity(ies) as sources of power relations
Chiara Giordano
〉Chargée de recherches FNRS
〉Group for Research on Ethnic Relations, Migration and Equality (GERME)
〉Université Libre de Bruxelles
〉chiara.giordano@ulb.be 〉
〉Article court 〉
Télécharger l'article. 2-2024 Giordano
Résumé : La notion de care transcende les simples actes de soins physiques pour englober un ensemble de pratiques sociales, émotionnelles et morales – une véritable « éthique du care » dans une « société du care » – qui structurent nos vies et nos relations (Tronto, 1993 ; Paperman, 2015 ; Ibos & al., 2019). Au cœur de cette dynamique se trouve le travail de care, au sens d’un ensemble d’activités et de pratiques professionnelles (ou pas) désignant le soin (généralement non curatif) à la personne, qui est un travail souvent invisible et intimement lié au domaine privé des bénéficiaires (Hirata, 2021).
Mots clés : Care, rapports de domination, travailleuses migrantes, travail émotionnel, proximité
Abstract: The opposition between proximity and distance offers a unique lens through which to understand the complexity of care work. This article explores this tension in the specific context of care work with older people, carried out by migrant women workers. By analysing different forms of proximity(ies) and distance(s) (geographical, physical, emotional and human) and the way they are articulated, we can shed light on unbalanced power relations, to the detriment of female care workers.
Keywords: Care, power relations, migrant workers, emotional work, proximity
En m’appuyant sur une recherche menée en Belgique entre 2018 et 2022, j’explorerai dans cet article ce travail de care dans le contexte spécifique des personnes âgées et des travailleuses migrantes qui s’occupent d’elles à domicile. Cette intersection offre un terrain fertile pour examiner les tensions complexes entre la distance et la proximité qui sous-tendent les relations professionnelles et humaines de ce type de care. En effet, le travail de care exige inévitablement une proximité physique, émotionnelle et morale, qui s’explique également par le fait de se déployer au sein de l’espace privé des bénéficiaires. La nature même de ce travail, effectué dans l’intimité et souvent invisible aux yeux du public, soulève des questions cruciales sur la reconnaissance et la valorisation de ces activités (Devetter & al., 2009 ; Tronto, 1993).
La proximité dans le care n’est pas sans ambiguïté. Elle peut être teintée de rapports de domination, de relations asymétriques et de frontières souvent floues entre le professionnel et le personnel. Par ailleurs, comme le soulignent nombre de travaux récents, le secteur du care est non seulement fortement féminisé, mais également composé d’un nombre croissant de travailleuses migrantes ou d’origine étrangère, phénomène majoritairement visible en Europe dans les centres urbains (Horn & al., 2021 ; Giordano, 2022). Les dynamiques de genre, de race et de migration influencent profondément les interactions dans le travail de care, en ajoutant une complexité supplémentaire qui peut être analysée en termes de proximité et de distance.
Un réflexion approfondie sur les différentes formes de proximité qui caractérisent le travail de care devient essentielle pour saisir ses dynamiques et son évolution et permet de mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les travailleuses migrantes et les personnes âgées, tout en soulignant l’importance de repenser les normes et les valeurs qui régissent ces relations fondamentales du travail de care.
La discussion que je propose dans cet article se base sur les résultats d’une recherche réalisée dans la région de Bruxelles-Capitale, en Belgique[1]. En utilisant des méthodes mixtes, cette recherche explorait le travail de care aux personnes âgées du point de vue des employeurs et des travailleuses migrantes, avec ou sans contrat régulier. Bien que pour des raisons d’espace il ne me soit pas possible de présenter des citations directes ou des exemples, mon analyse est basée sur un travail de terrain réalisé en trois parties : (i) 15 entretiens approfondis avec des employeurs externes ; (ii) une enquête quantitative, accompagnée de 35 entretiens approfondis, avec des personnes âgées ou des membres de leur famille ; et (iii) 30 entretiens approfondis avec des travailleuses migrantes, avec différents statuts administratifs et de travail.
Distance(s) et proximité(s) dans le travail de care aux personnes âgées
La notion de care offre une lentille analytique utile à travers laquelle explorer les multiples dichotomies utilisées dans le domaine sociologique, telles que féminin/masculin, nature/culture, raison/émotion, public/privé, travail productif/ reproductif, entre autres (Ibos & al., 2019) et interagit avec ces dichotomies, les interrogeant et révélant leurs interconnexions profondes. De même, l’opposition entre proximité et distance offre un prisme unique à travers lequel comprendre la complexité du travail de care. Je considère que l’opposition (et l’interaction) entre proximité et distance se manifeste dans ce contexte à au moins quatre niveaux distincts.
Au niveau géographique, la situation des travailleuses migrantes, souvent caractérisée par une distance physique importante avec leurs familles dans le pays d’origine, incarne la question de la distance et de la proximité. D’une part, elles font l’expérience de la distance au quotidien, en vivant séparées de leurs familles dans leur pays d’origine ; d’autre part, elles préservent la proximité avec les membres de la famille et souvent avec d’autres membres de la communauté grâce aux moyens de communication tels qu’internet et le téléphone. En effet, la circulation du care dans un espace transnational doit être pensée non seulement comme la mobilité d’une main-d’œuvre féminine d’un point à un autre de cet espace, mais aussi comme le maintien, à distance et avec différents outils, de pratiques de care qui peuvent être innovantes et tout aussi efficaces que le « care en présence » (Tedeschi & al., 2022).
Sur le plan physique, la dichotomie entre distance et proximité dans le care passe aussi par l’opposition entre espace public et espace privé et est profondément liée à l’organisation spatiale et temporelle du travail. Le travail se déroule dans l’intimité du domicile du bénéficiaire, créant une proximité physique étroite, et donc relève entièrement du domaine privé, en opposition au public (Memmi, 2016). Le manque de distance physique peut avoir des conséquences particulièrement sévères pour les travailleuses qui résident au domicile de la personne âgée, pour lesquelles la séparation entre travail et vie personnelle devient presque inexistante. Dans ce cas, la distance physique se réalise uniquement lorsque la travailleuse s’approprie de l’espace public pour des activités liées au travail ou, moins souvent, personnelles.
Sur le plan émotionnel, le travail de care implique la création de liens affectifs entre la travailleuse et la personne âgée. Le fait de travailler dans l’espace privé de la personne âgée, mais aussi de s’occuper de son intimité (à travers des tâches liées à l’hygiène, par exemple) et de son intime (soutien moral, accompagnement, etc.), implique un travail émotionnel, voire la création de liens, de sentiments, d’attachement entre les deux parties. Dans ce contexte, l’opposition entre distance et proximité est souvent discutée en termes de vision du travail de care, entre mise à distance et attachement, le premier vu comme une forme de professionnalisation ou de protection de la travailleuse (Avril, 2014), le second comme faisant partie de la nature du travail, donc inévitable (Hirata, 2021). Cette opposition entre distance et proximité se traduit donc par un questionnement sur la manière de gérer les sentiments et les liens émotionnels dans un cadre professionnel.
Pour finir, au niveau humain, la question de la proximité joue un rôle crucial dans la construction de la relation professionnelle, en opposition à la relation familiale. Dans le travail de care, tout comme dans le travail domestique, on est en présence d’une tension entre la nécessité, de la part de l’employeur ou du bénéficiaire, de marquer la distance avec la travailleuse, et la nécessité de cacher cette distance. D’une part, la distance est nécessaire pour maintenir la relation de travail au niveau professionnel et elle est utilisée pour marquer la séparation entre celui qui reçoit les services (celui qui est servi) et celle qui preste ce service (celle qui sert). Cette distance, qui se manifeste notamment à travers une différence en termes de classe sociale, de niveau d’éducation et/ou d’origine de la travailleuse, devient un symbole d’altérité et qui sert de justification de la position asymétrique entre patron et subordonnée. D’autre part, les employeurs minimisent volontairement cette distance – du moins sur le plan théorique – en jouant sur l’ambiguïté de la relation de travail. Le statut de ‘quasi-membre de la famille’ accordé à la travailleuse, qui cesse d’être considérée (ou de se considérer) en tant que telle et devient symboliquement membre de la famille, est bien connu dans la littérature sur la travail domestique et est à l’origine d’ambiguïté (Parreñas, 2015). Cette relation ambiguë engendre des liens de forte dépendance des deux côtés. Toutefois, elle est souvent intentionnellement établie et entretenue par le bénéficiaire ou la famille, en raison des nombreux avantages qu’elle offre à ces derniers. Ces avantages comprennent le dévouement de la travailleuse, qui se sent reconnaissante et est donc susceptible de fournir des services au-delà des termes contractuels convenus, ainsi que de respecter des horaires flexibles, entre autres bénéfices.
Discussion
Cette brève analyse des différentes formes de proximité et de distance qui s’entremêlent dans la relation de care montre un déséquilibre dans les relations de pouvoir, au détriment des travailleuses. La distance géographique entre la travailleuse, sa famille et son réseau familial et communautaire, ainsi que le manque de visibilité dans l’espace public, peuvent augmenter la vulnérabilité des travailleuses, à plusieurs niveaux (isolement et difficultés dans la création d’un capital social et l’accès aux ressources et aux services, entre autres). En outre, comme le souligne Memmi dans ses travaux (2016), la proximité physique et émotionnelle entre les acteurs, qui engendre des relations complexes où les frontières entre vie privée et professionnelle sont floues, crée des formes de « domination rapprochée ». De plus, le statut de ‘quasi-membre de la famille’ renforce non seulement l’ambiguïté de la relation, créant des attachements parfois difficiles à gérer, mais s’avère également fictif lorsque la relation de travail prend fin (décès ou départ de la personne âgée vers des structures d’accueil). C’est notamment à ce moment-là que la relation de travail réapparait de manière brutale et la distance est remise à l’avant et prédomine sur la relation familiale et les liens qui se sont construits entre la travailleuse et la famille. Ce passage d’abord progressif entre distance et proximité, puis brutal entre proximité et distance, sur lequel la travailleuse n’a aucun contrôle, contribue au maintien des rapports de domination.
En regardant de près ce jeu complexe qui entremêle distance et proximité dans le care, on observe, plus précisément, que les éléments qui ont des conséquences désavantageuses pour les travailleuses et qui contribuent au maintien et au renforcement des rapports de domination sont i) la distance géographique entre la travailleuse migrante et sa famille ; ii) la proximité physique entre travailleuse et bénéficiaire dans une logique d’intimité forcée dans l’espace privé ; iii) la proximité émotionnelle et relationnelle ; et iv) la (re)mise à distance de la travailleuse à certains moments de la relation et de manière abrupte quand la personne âgée décède.
Néanmoins, cette interconnexion entre proximité et distance est aussi utilisée par les travailleuses elles-mêmes, qui utilisent certains éléments liés à la proximité comme des véritables stratégies. Parmi ces éléments, on peut identifier les suivants : i) la proximité avec la famille dans le pays d’origine, qui est maintenue à travers les moyens de communication et qui est une proximité non physique mais néanmoins réelle ; ii) la distance physique et/ou émotionnelle, qui peuvent être mises en place comme stratégies de professionnalisation et de protection contre les risques liés au travail émotionnel (surinvestissement, attachement, manque de séparation entre vie professionnelle et loisirs, etc.) ; et iii) la proximité avec l’employeur, comme forme de capital social, qui peut être mobilisée après la fin de la relation de travail pour des raisons professionnelles (trouver un autre emploi) ou personnelles.
Références bibliographiques :
Avril C., 2014. Les aides à domicile: un autre monde populaire. La Dispute.
Devetter F., Jany-Catrice F. & Ribault T., 2009. Les services à la personne. Paris: La Découverte.
Giordano C., 2022. Ethnicisation and Domesticisation: The Impact of Care, Gender and Migration Regimes on Paid Domestic Work in Europe. Springer Nature.
Hirata H., 2021. Le care, théories et pratiques. La Dispute.
Horn V., Schweppe C., Böcker A. & Bruquetas-Callejo M., 2021. The Global Old Age Care Industry: Tapping into migrants for tackling the old age care crisis. Springer Nature.
Ibos C., Damamme A., Molinier P. & Paperman P., 2019. Vers une société du care. Une politique de l’attention.Le Cavalier Bleu.
Memmi D., 2016. « Aides à domicile et domination rapprochée ». La vie des idées, 4.
Paperman P., 2015. « L’éthique du care et les voix différentes de l’enquête ». Recherches féministes, 28(1), 29-44.
Parreñas R. S., 2014. “Migrant domestic workers as ‘One of the family’”. In Anderson B. & Shutes I., Migration and care labour. Theory, policy and politics. London: Palgrave Macmillan.
Tedeschi M., Vorobeva E., & Jauhiainen J. S., 2022. “Transnationalism: current debates and new perspectives”. GeoJournal, 87(2), 603-619.
Tronto J., 1993. Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. Routledge.
[1] La recherche est financée par Innoviris, programme « Anticipate » (projet MIRAGE) et par le Fond de la Recherche Scientifique (F.R.S-FNRS 33692031).
Pour citer cet article :
GIORDANO Chiara « Care aux personnes âgées et travailleuses migrantes : distance(s) et proximité(s) comme sources de rapports de domination », 2 | 2024 – Le care : une notion des proximité(s) ?, GéoProximitéS, URL : https:// geoproximites.fr/ark:/84480/2024/06/01/ care-ac24/